Au cœur de la complexité humaine par Pierre Jeanneret

Article de Marianne Wanstall pour la Vie Protestante
Serge Bimpage a l'immense privilège d'être un proche de Nicolas Binsfeld, qui a créé pour lui la couverture de son dernier ouvrage. Cette extraordinaire peinture, qui «grenouille» allègrement d'un vert aguicheur, est à mille lieues de faire le buzz sur le kidnapping de la fille de Frédéric Dard (auteur des San-Antonio) par un caméraman de la TV suisse, dont il est question dans le livre. Cette couverture nous conduit en revanche habilement sur la piste des grenouilles vertes qui se rapportent à la fois aux dollars qui remplissaient les poches des soldats Blancs qui combattaient les Sioux en Amérique et à l'argent qui sert de moteur à l'action d'Edmond, le ravisseur de la jeune Albertine.
Si l'analyse et la psychologie des personnages de son roman sont si fines et abouties, c'est sans doute que Serge Bimpage se destinait à la psychanalyse avant de se tourner vers l'écriture. Si l'on sent aujourd'hui un homme qui a su trouver le juste équilibre entre son métier de journaliste, de «nègre» et d'écrivain - comme Nazowski, le narrateur de son livre - on est en droit de se demander pourquoi diable il s'est mis à ressasser un fait divers qui remonte à 1983? Tout simplement parce qu'au fil du temps il s'est découvert un singulier intérêt pour les proscrits et qu'il a voulu savoir comment ils en étaient arrivés là. En creusant au fin fond de l'âme de ses personnages, il s'est aussi demandé si un romancier avait le droit de tout dire? Il en est arrivé à la conclusion que «les personnes réelles dont on s'inspire - au même titre que les personnages - ont un droit et même une influence sur l'écrivain comme sur son écriture».
S'il cherche à «donner la parole à ceux qui ont vécu un drame et en sont dépourvus», les contacts avec Albertine et Edmond ne sont pas sans incidence sur la propre vie de Nazowski - qui non sans autodérision, se fait appeler «Naz»! Pour mener à bien la commande de son éditeur, Naz passe des heures à sonder le passé et le caractère d'Edmond pour expliquer les ressorts qui l'ont conduit à kidnapper une fille de l'âge de la sienne, car il ne pense pas qu'il soit «un monstre» comme l'a tonné le procureur général lors de son procès. Idem pour les longs moments passés auprès d'Albertine, tant comme «nègre» professionnel, ami et confident que sorte de «psy», pour connaître les multiples étapes qui lui ont permis de se reconstruire après son traumatisme. Mais outre cette héroïne bien malgré elle, le rôle de deux autres femmes est loin d'être négligeable. Il y a d'abord Esther, l'épouse de Naz, toujours prête à le remettre droit dans ses bottes. Elle fait toutefois confiance à son séducteur de mari sachant qu'il fera toujours passer l'éthique professionnelle avant ses propres désirs. Nusch, ensuite, la femme du ravisseur, fière de celui qui ramène de l'argent à la maison mais assez «nunuche» pour fermer les yeux sur sa provenance lorsqu'il lui demande de l'aider à fondre de l'argenterie, produit de son dernier «casse»!
Quand cette obsession de l'argent aura-t-elle enfin fini de pervertir l'humanité? Et si c'était cela le vrai sujet de La Peau des grenouilles vertes?
Quoi qu'il en soit, chapeau à l'auteur pour la chute! Certes, on s'attendait à un revirement dramatique, Naz risquant de ne toucher aucune «grenouille» pour son travail, Edmond et Albertine s'étant rétractés au tout dernier moment et lui interdisant de publier ce qu'ils lui avaient raconté.
Mais si vous voulez la connaître, précipitez-vous pour acheter le livre, la fin est à mille lieues de tout ce qu'on pouvait imaginer. Pas aussi «naze» que ça, Serge Bimpage...en tout cas jamais à court d'inspiration pour nous bluffer!
Marianne Wanstall-Sauty
Entretient avec Amandine Glévarec
Entretien à propos de La peau des grenouilles vertes avec Amandine Glévarec, sur le site littérature-romande.net
Amandine Glévarec – Albertine demande à Naz, votre narrateur, pourquoi il s’est intéressé à son histoire à elle. Je vous retourne la question, pourquoi avoir écrit ce roman en vous inspirant de l’affaire Dard ?
Serge Bimpage – Le choix du sujet est souvent un mystère pour les écrivains eux-mêmes. J’avoue que je ne le sais pas moi-même, ou du moins pas exactement. En tout cas, ce fait divers m’avait marqué à l’époque, il m’a travaillé de longues années sans que je sache véritablement à quel niveau. Il fallait donc que je m’y plonge, que j’écrive dessus pour en exorciser le sortilège. C’est pourquoi je cite cette phrase de Julien Green, en exergue : « J’écris des livres pour savoir ce qu’il y a dedans. » Une chose est certaine, plusieurs de mes livres (La seconde vie d’Ahmed Atesh Karagün,La Reconstitution,Moi, Henry Dunant j’ai rêvé le monde) donnent la parole à des gens qui en ont été privés. ll n’y a rien de pire, pour un homme, que de vouloir exprimer quelque chose d’important sans parvenir à le faire. Surtout quand il a vécu un drame. C’est le cas des protagonistes de ce roman.
A. G. – Il y a une mise en abyme fabuleuse dans votre récit car tous ceux qui connaissent le fait divers réel le reconnaîtront, mais personne ne saura à quel point Naz est inspiré de vous, ni dans quelles circonstances vous avez pu rencontrer les véritables protagonistes. Comment doit-on lire La Peau des grenouilles vertes pour résister au vertige, comme un roman, un documentaire, une autofiction ?
S. B. – Les classifications ne me disent rien qui vaille. Cela dit, vu le degré d’invention, il s’agit bel et bien d’un roman, qui exploite à fond le « mentir-vrai » pour tenter de s’approcher d’une vérité. Car, et c’est ce qui m’a attiré dans ce fait divers, on peut y découvrir plusieurs thèmes métaphysiques, qui se superposent et se répondent : l’obsession éternelle de l’argent, bien sûr, mais aussi le destin « contre nature » de certaines vies, la difficulté de se réaliser au pays du bonheur, la relation entre réalité et vérité. A quoi s’ajoute une problématique plus spécifiquement littéraire. Celle du rapport de l’écrivain à ses personnages. A cet égard, le personnage de Naz m’a été très utile. Il est le vecteur de tous ces thèmes. Comme journaliste, il fut hanté par cette contradiction ontologique entre la relation prétendument objective des faits et ce qui se cache véritablement derrière. Comme « nègre », il se rend compte que tout ce qu’il écrit ne lui appartient pas et qu’il ne pourra jamais en signer l’authenticité. Enfin, comme romancier, il comprendra que si la fiction se rapproche le plus de la vérité, elle ne saurait en garantir la pureté.
A. G. – Pourquoi Naz n’arrive-t-il pas à écrire une pure fiction ? La fiction est-elle toujours inspirée de la réalité ?
S. B. – Je ne connais pas de pure fiction, tout écrivain s’inspire de son vécu, l’inspiration ne tombe jamais du ciel. De plus, Naz n’aurait pas pu inventer l’histoire si rocambolesque de cet enlèvement. En ce sens, on peut dire que le fait divers est plus puissant que la fiction. Au reste, ce n’est pas le fait divers en soi qui intéresse le narrateur – ni moi-même – mais bien les questions qu’il soulève et les vérités qu’il dissimule ou révèle. Fernando Pessoa le dit autrement dansLe livre de l’intranquillité : « Les choses n’ont de valeur que l’interprétation qu’on en donne ».
A. G. – Ce qui nous entraîne dans la question du droit de disposer de la vie d’autrui et de l’intégrer dans une fiction. Pourquoi avoir changé les noms, les professions ? Par pure peur d’un procès ou pour brouiller les pistes ? Une certaine auteure française ne s’est jamais privée de mentionner des noms, au grand dam de son avocate, quelle est la limite à ne pas franchir ?
S. B. – L’auteure à laquelle vous faites (vous aussi) allusion pratique un radicalisme littéraire que je n’approuve pas. Le problème de fond réside en effet dans l’affrontement de deux droits d’égale importance : la liberté d’expression, ou de création, et la protection de l’intimité. L’un ne doit pas prévaloir sur l’autre. Pour ce qui me concerne, la limite est celle du respect. Si l’écrivain aime ses personnages même les plus détestables – conseil et condition pour bien écrire que m’avait prodigué Marguerite Yourcenar à Mont Desert -, il ne cède à aucun moment à la diffamation. C’est ce respect qui invite à déplacer le plus possible, à changer les noms et les professions. Je répète que ce qui intéresse la littérature n’est pas plus la réalité des personnages dont elle s’inspire que celle du fait divers en tant que tel, mais les ressorts humains dans ce qu’ils ont d’universel. C’est pourquoi je désapprouve une démarche qui consisterait à régler ses comptes avec des personnages réels ; elle rendrait un mauvais service à la littérature.
A. G. – Joséphine a très longtemps refusé de parler de son histoire. Je ne vous demanderai pas dans quelle mesure ce qui se passe entre Albertine et Naz à la fin de votre roman est vrai, mais pouvez-vous tout au moins nous préciser si elle a lu votre manuscrit, et si oui ce qu’elle en a pensé ?
S. B. – Tout au long de la construction du roman, j’avais à l’esprit Albertine. Il eût été bien sûr impensable de ne pas tenir compte de la victime. J’ai déployé beaucoup d’efforts pour tenter de me représenter le traumatisme qu’elle avait subi, surtout, comment elle était parvenue à se reconstruire, à faire preuve d’une impressionnante résilience. Sa personnalité poétique et sa seule présence tout au long de la rédaction constituaient un heureux contrepoint au personnage déprimant d’Edmond K. Tout cela en imagination, bien sûr. Elle était là aussi pour me rappeler constamment toute l’horreur du forfait de son ravisseur. J’ai envoyé le livre à Joséphine, mais nous sortons là de la question littéraire.
A. G. – Vous avez le sens de la formule. J’ai été très marquée, entre autres, par cet extrait : « L’affaire Onson, les histoires des autres, elles t’évitent la première personne, Naz. C’est ton crime et ton alibi. » Quel est le crime, et quel besoin d’un alibi ? Que Serge Bimpage cache-t-il pour préférer éviter d’avoir à parler de lui ?
S. B. –Votre question confirme que nous avons bien affaire à un roman, et non à une autofiction ou un récit de vie. Le personnage de la femme de Naz, qui prononce cette phrase, sert à soulever la question du masque chez l’écrivain. Le ravisseur, singulièrement, se fait attraper à cause du masque qu’il porte pour chercher à se dissimuler. L’écrivain, pour toucher à l’universel, doit aussi avancer masqué, éviter de trop parler de lui, de ses propres démons pour laisser la place au sujet et entrer résonnance avec le lecteur. Mais rassurez-vous, je n’ai tué personne !
A. G. – Question subsidiaire : je comprends votre titre car votre roman en donne la référence et l’explication. Néanmoins, pourquoi l’avoir appelé La Peau des grenouilles vertes, alors que finalement l’argent n’est pas vraiment le sujet central de votre livre ?
S. B. – Bien sûr que si ! Voilà un personnage que tout conduit à se persuader que l’argent mettra fin à ses problèmes ! Au point qu’au fil de ses brigandages, escroqueries et contrefaçons, se rendant compte que ce processus diabolique risque de le perdre, il caresse l’idée d’un coup ultime – un enlèvement contre une formidable rançon – pour le tirer de sa double vie. L’argent par l’argent, comme on dit le mal par le mal. En prison, il aura tout le temps de méditer cela. Il sera d’ailleurs bouleversé par la lecture des mémoires du chef sioux Tahca Ushte, en particulier le passage évoquant la malédiction des « peaux de grenouilles vertes » que sont les dollars.
Amandine Glévarec
Gilbert Salem
Un "raconteur de vies" décrypte un kidnappeur
Dans son cinquième roman, Serge Bimpage fictionnalise un fait divers retentissant qui a eu lieu en terre romande.
Saisir une affaire criminelle qui a fait sensation dans les médias, l’étudier plus attentivement, puis la retourner comme un gant pour la rendre romanesque. Telle fut en 2007, le succès de Jacques Chessex, avec son Vampire de Ropraz. L’exercice est de plus en plus couru dans la production littéraire, et l’auteur genevois Serge Bimpage vient de s’y distinguer remarquablement, et tout à sa manière.
L’onzième de ses livres – voilà quelque 30 ans qu’il en publie – est un roman dont la narration pivote autour d’une célèbre affaire de rapt qui remonte à 1983. Celui, près de Genève, de Joséphine Dard, fille du grand Frédéric, l’auteur des San-Antonio… Elle avait alors 13 ans quand elle fut kidnappée avec violence par un cameraman de la Télévision romande, qui réclama vainement une rançon, fut finalement attrapé, jugé, emprisonné, puis libéré.
Un «monstre» au passé tragique
En focalisant sa demi-fiction sur le déroulement du procès du ravisseur, qu’il appelle Edmond K., Bimpage fait assister aux séances un narrateur au patronyme de Nazowki, alias «Naze». Un ancien journaliste d’investigation reconverti en «nègre», et qui brade ses talents de chroniqueur en rédigeant pour d’autres des «autobiographies». Au mot «nègre», il préfère pertinemment l’étiquette de «raconteur de vies».
Parmi les autres protagonistes du livre. Joséphine Dard devient une Albertine peu proustienne, dont Naze sera tenté d’écrire les mémoires. Mais c’est le destin dévoyé du ravisseur Edmond K. qui monopolise toute l’attention du lecteur: ce «monstre» comme le désigneront ses juges a eu certes un passé tragique, mais qui ne justifie rien.
Gilbert Salem, Tribune de Genève
Alain Bagnoud
Une ténébreuse affaire
Serge Bimpage a bien eu raison de transformer un fait divers qui l’obsédait en roman. En créant dans son livre un labyrinthe de mentir-vrai, il se pose la question du destin des individus et interroge le réel et l’écriture, grâce à une histoire passionnante.
La peau des grenouilles vertes est en effet inspirée par un fait judiciaire réel, que Bimpage avait suivi professionnellement, il y a des années. L’affaire Joséphine Dard. Joséphine est la fille de Frédéric Dard, le célèbre écrivain qui avait créé San Antonio. La fillette âgée alors de treize ans avait été enlevée dans leur maison de Vandoeuvres.
Serge Bimpage reprend avec fidélité les détails de l’histoire, tout en transposant personnages et lieux. Mais on retrouve l’environnement de l’affaire et les personnalités des protagonistes.
Le portrait du ravisseur occupe une place importante dans le livre. Il faut dire que son profil est atypique. Fils d’une famille noble et importante, que les frasques d’un père écrasant ont appauvrie et détruite, ayant bénéficié d’une éducation aristocratique, il rêve de devenir cinéaste, mais finit caméraman à temps partiel à la télévision suisse romande. Bon mari, excellent père, charmant collègue, il est aussi pendant dix ans, à l’insu de tous, un as du cambriolage. Un virtuose.
Ses tournages pour la télévision lui permettent de repérer les lieux. Il retourne ensuite de nuit dans les demeures qui l’intéressent, photographie des objets de prix: livres anciens, gravures. Puis dans son atelier de bricoleur, il réalise desfac-similés. Enfin, à la faveur d’une deuxième visite, il échange les originaux contre ses artefacts.
La vente des vols à des antiquaires lui permet de mener un grand train de vie. Mais il a peur de se faire attraper et décide de terminer sa carrière criminelle par un grand coup. Un enlèvement. C’est à la faveur d’un reportage qu’il pénètre chez sa future victime. La fille de l’artiste à succès a quasiment l’âge de la sienne. Ça le décide.
Bimpage décrit l’enlèvement, la séquestration, les demandes de rançon en se basant sur la documentation impeccable qu’il a accumulée. Il n’a pas besoin de broder, tant l’affaire, jusque dans ses moindres détails, est d’un romanesque achevé.
Le bandit a préparé minutieusement son coup, avec un luxe de précautions: petit téléphérique pour récupérer le sac d’argent, indications glissées dans le bottin d’un téléphone public, somnifères, appartement loué à Annemasse. Trop minutieusement, même. Ça le perd, finalement. Quand il passe un coup de télé- phone au père depuis une cabine, il revêt un masque de carnaval. Deux amoureux le remarquent, notent le numéro de sa voiture, font le rapprochement avec l’affaire.
Toute cette histoire est passionnante. Ce qui l’est encore plus, c’est la manière dont Bimpage traite le sujet. Son narrateur, Nazowski, Naze pour les intimes, est un nègre, habitué à rédiger les récits de vie de ceux qui le paient pour ça. Il a suivi jadis l’affaire pour un journal. Depuis, elle le hante. Il en garde le sentiment qu’il n’est pas allé au bout de ce qu’il pouvait dire, qu’il a été cantonné aux faits bruts par les règles de son métier. Et autre chose : « J’ai toujours marqué un faible pour les hommes que le destin force à marcher contre nature.»
On lui apprend qu’Edmond, le ravisseur est sorti de prison. Il le contacte. Tous deux s’entendent à faire un livre de cette histoire, mais Edmond reste à la surface des choses, puis, finalement, renonce.
Naze file alors à Paris, à la recherche de celle qui a été enlevée. Une rencontre et des entretiens suivent. Elle se dévoile, mais finalement, refuse aussi qu’il écrive son histoire. C’est alors que le nègre décide d’écrire un roman.
Ce dispositif narratif introduit le lecteur dans un labyrinthe de miroir. Qu’est-ce qui est finalement vrai? Qu’est-ce qui appartient à la fiction? La transposition romanesque permet à Bimpage de se demander ce que peut l’écriture. Réussit-elle à comprendre les autres en pénétrant dans leur vie comme un voleur pénètre dans une maison qu’il veut dévaliser?
Sous les portraits des protagonistes principaux de l’affaire, dont Naze veut sonder la profondeur pour atteindre une vérité, on reconnaît évidemment les êtres de chair dont les articles ont parlé. On trouve aussi des personnages à clé, facilement identifiables. L’écrivain Claude Delarue est nommé pour l’occasion Claude Duchemin. Nejean Niver, un beau et jeune auteur à succès, auteur d’un roman qui a eu un succès fou. Ou un cinéaste avec qui le narrateur fait des trajets en train, Jean-Luc Gaddor.
Mais il ne s’agit pas seulement de les mettre en scène. Bimpage, dont le talent est arrivé à plénitude, se sert d’eux pour interroger son art, se demander ce qui, finalement, fonde la littérature.
Ce qui la fonde? Peut-être ce que Gaddor explique dans une formule lapidaire: « L’histoire n’a pas d’importance. Ce qui compte, c’est le regard. »
Voici ce que Naze découvre en écrivant son livre. « La vraie question, ai-je fini par comprendre, est celle du rapport de l’écrivain à son sujet. »
Quant au superbe titre, si vous voulez le comprendre, il faudra acheter les mémoires de Tahca Ushte, chef sioux. Ou en tout cas lire La peau des grenouilles vertes.
Alain Bagnoud
Source: editions-aire.ch
Jean-Michel Olivier
Une passionnante affaire (Serge Bimpage)
Tout est crypté, ou presque, dans le dernier roman de l’écrivain genevois Serge Bimpage. Le titre, tout d’abord,La Peau des grenouilles vertes*, qui ne trouve son explication qu’à la page 109 (allez-y voir vous-mêmes, si vous ne me croyez pas !). Le nom des personnages ensuite : un écrivain suisse, exilé malheureux à Paris, qui s’appelle Claude Duchemin, fait penser à Claude Delarue, disparu en 2011. Un cinéaste amateur de havanes, rencontré dans le TGV, évoque immanquablement le prophète de la Nouvelle Vague (il s’appelle Jean-Luc Gaddor). Quant à la trame du roman (l’enlèvement de la fille d’un artiste célèbre), elle fait penser à l’affaire Dard, survenue en 1983, à Genève, qui avait fait grand bruit. Ici, Joséphine Dard (voir ici son interview) devient Albertine Onson, et son père Frédéric, Nils Onson. Quant à Bimpage, qui aime les masques et les pseudos, il devient Nazowski (surnommé Naze). Mais ne nous y trompons pas : La Peau des grenouilles vertes, malgré les apparences, n’est pas un roman à clés : c’est une enquête, passionnante et fouillée, autour d’un fait divers qui met en évidence toutes les facettes de l’âme humaine — ses ombres et ses lumières.
Qui est Naze ? Un nègre d’écriture. « Un raconteur de vies », comme il se nomme lui-même. Il a quitté le journal pour lequel il travaillait pour se mettre à son compte, et écrire, car telle est sa passion, et son ambition. Il est le scribe fidèle, le témoin attentif, qui va donner forme (et cohérence) aux vies qu’on lui raconte. Qui connaîtrait Socrate si Platon n’avait pas retranscrit fidèlement ses paroles, et sa philosophie ?
Les nègres sont utiles, et même indispensables, on ne le dira jamais assez…
Mais l’écriture n’est pas qu’une affaire de commande ou de métier. Naze s’en est vite aperçu. Elle plonge en lui ses racines profondes. Autrefois journaliste, puis nègre, il a toujours rêvé d’être écrivain. C’est ici que les choses se compliquent, et deviennent passionnantes.
Fasciné, depuis longtemps, par un fait divers (l’enlèvement d’Albertine Onson), Naze va mener discrètement son enquête, comme un limier, et écouter les témoignages (peut-on parler de confessions ?) des deux protagonistes de cette sinistre affaire. Le nègre, alors, devient psy : il écoute, interprète, essaie de débrouiller l’écheveau si subtil des paroles prononcées. Edmont K., le ravisseur, l’effraie, d’abord, puis joue au chat et à la souris. Aujourd’hui, on le classerait dans la catégorie despervers narcissiques. C’est un manipulateur sans envergure, mais à l’ego tout- puissant. Naze reste fasciné, mais toujours sur ses gardes. Il reconstitue son enfance, les humiliations subies face à son père, ses déboires dans une société où il ne trouve pas sa place. L’arrière-fond criminel est parfaitement décrit, avec empathie, mais sans pathos. Edmont K. est un homme ordinaire, c’est là son drame, attiré par l’appât du gain, inconscient des souffrances qu’il peut (et va) causer.
Le cas d’Albertine est beaucoup plus intéressant. Sa vie croise celle de Naze en plusieurs points : elle devient l’amie de Claude Duchemin, que Naze admire, et qui lui lègue son appartement parisien. L’évocation de l’écrivain suisse exilé (alias Claude Delarue) est belle et émouvante (et pourrait être développée). Elle exerce sur Naze une attraction qui le poussera dans ses derniers retranchements. Car raconter la vie des autres, recueillir leurs paroles, n’est pas sans danger. On en dit toujours trop, ou trop peu. Naze est un scribe fidèle, certes, mais il sent les limites de son métier : la vérité ne se dit pas comme ça. Maquillée, travestie, elle ne sort pas toute nue de la bouche du bourreau, comme de celle de la victime. L’un et l’autre ne peuvent pas tout dire. Seul le roman — par son espace de liberté, ses voix multiples, ses spéculations, ses outrances — peut approcher la vérité du réel.
Et Naze en est le premier conscient…
À qui appartient une vie ? À celui qui la vit ou à celui qui la raconte ?
C’est le dilemme de Nazowski, et l’enjeu central de son livre. Comme Serge Bimpage, il y déploie ses multiples talents : journaliste, il mène une enquête au cordeau, se déplace, interroge les témoins, repère les lieux du crime ; fin psychologue (et maïeuticien), il sait accoucher les personnes qu’il écoute et les comprend sans les juger, comme dirait Simenon ; et en bon écrivain, il donne forme à ce chaos de vérités, serré comme un nœud de vipères, dont il extrait un roman à la fois vif et attachant, parfois désabusé, plein de surprises et de retournements de situation, qu’on ne lâche pas jusqu’à la dernière ligne.
Jean-Michel Olivier
Le blog de Francis Richard
"Semper longius in officium et ardorem"
"Le combat corps à corps avait recouvert le champ de bataille d'un immense nuage de poussière où les peaux de grenouille verte des soldats tourbillonnaient comme des flocons dans la tempête."
Cette phrase est extraite d'un passage des mémoires de l'amérindien Tahca Ushte, où il raconte la bataille de Little Big Horn. Les soldats blancs venaient de toucher leur solde et leurs poches étaient pleines de billets verts...
Un certain nombre de romans ont pour sujet un fait divers. L'exemple qui vient immédiatement à l'esprit stendhalien est évidemment Le Rouge et le Noir. Mais il est bien d'autres exemples dans la littérature que celui-là.
Serge Bimpage écrit son roman à partir du rapt réel de la fille d'un écrivain célèbre par un caméraman de la télévision suisse. L'affaire, qu'il transpose et qui remonte à un peu plus de trente ans, avait à l'époque défrayé les chroniques genevoises et bien au-delà.
Nazowski, Naz pour les intimes, se voit proposer par son éditeur d'écrire un livre sur un sujet en or, la vie d'Edmond K., qui vient de sortir de prison. Edmond K. a en effet enlevé Albertine, la fille du cinéaste Nils Onson, il y a quelque dix ans de cela.
Naz, après avoir été journaliste, a changé de métier. Il est devenu nègre. Il est passé en quelque sorte de l'écriture sur des faits à l'écriture sur commande. Mais écrire sur Edmond K. est un tout autre défi, parce que ce dernier ne lui a rien demandé.
Considéré comme un monstre, Edmond K. n'a pas eu beaucoup le loisir de s'exprimer sur les motivations de son crime. Le livre commence d'ailleurs par cette phrase : ""D'un monstre, il n'y a rien à entendre!" avait tonné le procureur général."
On ne s'était pas intéressé à la vérité d'Edmond K. à l'époque et on ne s'était pas intéressé davantage à celle de sa victime, Albertine. Naz va donc essayer de reconstituer les faits, de savoir pourquoi et comment ils se sont produits, de comprendre.
Pour cela il va rencontrer à plusieurs reprises Edmond et Albertine et leur donner la figure humaine qui ne leur a jamais été donnée jusque-là dans la presse. Il va entrer dans leur vie, la reconstituer dans leur milieu, avant, pendant et après le crime.
Naz apprend ainsi l'importance, sur la vie d'Edmond, de l'injonction de son aristocrate de père: "Ressemble!"; la peur des hommes, depuis l'enlèvement, qu'éprouve Albertine, la peur "de ce qu'ils veulent prendre", "ces avides".
Ces contacts avec Albertine et Edmond ne sont pas sans incidence sur la propre vie de Naz, sans doute parce qu'il s'investit beaucoup dans cette quête de leur vérité, dans cette plongée dans leurs profondeurs humaines:
"Je voudrais écrire comme un artisan. Tout entier dans le geste. Tandis que le geste d'écrire, hormis ces instants si fugaces qui me soulèvent et font oublier, ne s'accomplit pas sans souffrance."
Si La peau des grenouilles vertes n'est pas la seule motivation d'Edmond K., elle joue un rôle dans son passage à l'acte et elle en joue certainement un autre dans l'existence d'Albertine, son réalisateur de père ayant fait fortune "en racontant la pauvre vie des riches et la riche vie des pauvres".
Quant à Naz, même s'il ne s'est pas spécialement lancé pour l'argent dans sa quête de leur vérité, n'a-t-il pas droit à un peu de la peau des grenouilles vertes pour le temps qu'il perd en s'obstinant à la dévoiler cette vérité, au détriment de ses mandats?
Comme ni Albertine, ni Edmond ne sont finalement d'accord pour que Naz écrive tout ce qu'il apprend sur eux, à défaut d'être leur historien, il se voit en effet contraint de devenir leur romancier, ce qui n'est pas la plus mauvaise voie pour parvenir à la vérité, mais n'est pas sans danger...
Francis Richard

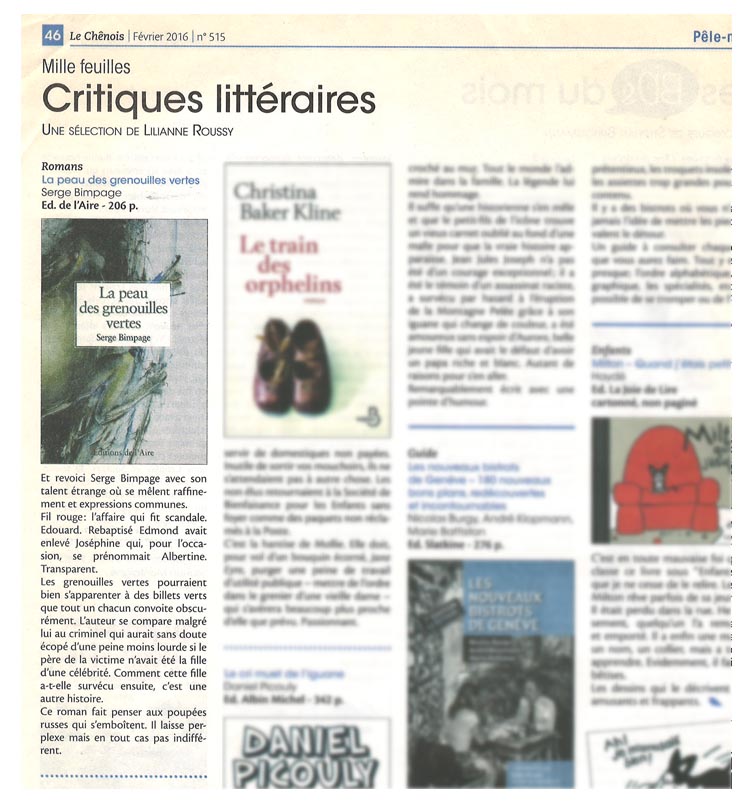


Critiques la peau des grenouilles vertes dans Le Courrier, 19 février 2016 par Marc-Olivier Parlatanto
ROMAN • «LA PEAU DES GRENOUILLES VERTES» DE SERGE BIMPAGE Dans les méandres d’un fait divers Les motivations enfouies et les ressorts psychiques les plus secrets des protagonistes se retrouvent au cœur de La Peau des grenouilles vertes, le sixième roman de Serge Bimpage, qui s’inspire d’un singulier «fait divers» survenu il y a une trentaine d’années: le rapt contre rançon de la fille d’un célèbre artiste – en l’occurrence l’écrivain Frédéric Dard, créateur de San Antonio.
En recourant ici à la forme romanesque, l’auteur genevois propose des portraits tant de la victime, Albertine, que du criminel, appelé Edmond K. L’intrigue s’enrichit de bribes de souvenirs, d’échos d’anciens événements, car, souligne le narrateur, «dans les anecdotes se loge souvent la clé de toute une histoire».
Adolescente, Albertine est enlevée par un homme qui la retient en captivité et lui injecte régulièrement une substance sédative. L’intensité dramatique est au rendez-vous dans ce livre, dont l’un des protagonistes, en-dehors du «couple» contraint formé par le ravisseur et sa proie, exerce le métier d’écrivain. Ce dernier se penche sur «les hommes que le destin force à marcher contre nature» et se met au travail.
But du narrateur: écrire un livre qui donnera la parole tant à Edmond qu’à Albertine. Récit du rapt, minutes d’une émission de télévision, plongée dans l’enfance du ravisseur, heurs et malheurs du narrateur concourent à assembler un puzzle où réalité et fiction se combinent. L’emboîtement des pièces est mené avec brio et subtilité. «Tout est faux, dans une reconstitution. On vous demande du bout des lèvres de jouer votre propre rôle, de crainte que vous ne rechigniez.» Ces mots, qui concernent un moment de procédure, peuvent tout aussi bien s’appliquer, en partie au moins, à la littérature, suggère Serge Bimpage.
Le personnage de Naz, qui va interviewer Albertine et Edmond, prend part à sa façon à une forme de reconstitution, quoique non judiciaire, de l’événement. En arrière-plan se pose la question du rôle de la fiction, de sa capacité à dépeindre et à comprendre autrui, à relater le passé. Avant que le roman ne s’achève sur une note inattendue, plaçant le lecteur face à un paradoxe, Edmond K., sorti de prison, profère ces mots après s’être entretenu avec Naz: «Voilà, vous savez tout, à vous de jouer.»
Marc-Olivier Parlatanto
Scènes Magazine
"Entretien: Serge Bimpage", dans Scènes Magazine
« L’amitié contient de l’amour, jamais l’inverse ». Le dernier roman de Serge Bimpage, Pokhara (Editions de L’Aire) est une interrogation poignante sur l’amitié, le mitan de la cinquantaine et le sens de l’existence. Entretien avec son auteur.
Viktor et Léon, les deux protagonistes de votre roman, effectuent un "trekking" dans les montagnes du Népal. Il s’agit en fait de retrouvailles...
A vrai dire, ils ne se sont jamais perdus de vue ! On pourrait même dire qu’ils n’ont jamais cessé de se tenir à l’œil, de guetter l’évolution de l’autre. C’est le lot de l’amitié.
Dans La chute, Camus montre comme l’amitié se conquiert péniblement, après quoi « il faut faire face » : à la différence, à la singularité de l’autre, ce qui exige beaucoup de maturité. Une douloureuse confrontation de cet ordre avait eu lieu vingt ans auparavant, justement à l’occasion d’un « trekking » dans l’Himalaya. Or, Viktor ne l’avait pas supportée.
C’est pourquoi, d’un accord tacite, ils décident de renouveler l’aventure en fêtant leur cinquantième anniversaire au même endroit. La métaphore est celle du mitan de la vie. On dresse le bilan ; douloureux dans la mesure où les portes des possibles se referment une à une ; merveilleux dans celle où l’on peut bénéficier du bien si précieux de l’amitié…
Laurent Cennamo
L'Echo Magazine
Léon et Viktor, une histoire d’amitié, dans L'Echo Magazine
« Pokhara », de Serge Bimpage, emprunte son titre à une localité népalaise. Deux amis qui ne se sont pas vus depuis longtemps décident de fêter leurs cinquante ans par une marche, passablement ascensionnelle, jusqu’aux pieds de l’Anapurna. Plusieurs années auparavant, Léon et Viktor avaient tenté pareille expédition, mais au dernier moment Viktor avait craqué. Aucun n’était revenu sur cet épisode.
Chargés de tout un matériel de survie, les voilà partis : « Le lendemain, ils se mirent donc en marche dès l’aube, empruntant un large chemin qui débutait par le franchissement d’une rivière. » Dès cet instant, le lecteur suit les deux hommes aussi bien dans leur longue avancée que dans le chaminement de leurs pensées. Leur amitié va-t-elle résister à la fatigue, à l’inconfort, à l’inconnu ?
Léon, plus aguerri à ce genre d’aventure, allait de son pas régulier, Viktor caracolait comme un chevreuil. Léon dut le rappeler à plus de sagesse, donc plus de lenteur réfléchie. L’un des deux n’atteindra pas le camp de base de la grande montagne.
C’est ce mystère du destin qui doucement se dessine dans l’écriture de Serge Bimpage, une écriture limpide, qui coule comme un torrent, tantôt légère, tantôt profondément interrogative et lucide.
Voilà un roman qui se lit d’une traite, parce qu’il n’est pas possible d’abandonner ces deux hommes qui avancent dans leur solitude.
Mousse Boulanger
Alain Bagnoud
"Article de Alain Bagnoud sur son blog"
Pokhara est un court texte elliptique qui semble la partie émergée d'un iceberg : on perçoit, sous la ligne de flottaison, une immense masse juste suggérée.
Viktor et Léon, deux vieux amis, fêtent leur cinquantaine dans les montagnes du Népal. Ils se connaissent depuis l'enfance, ils ne savent plus très bien quand ils se sont rencontrés pour la première fois. Pendant quelques jours dans ce décor grandiose, il est question entre eux de choses graves. De l'amitié, de la crise de la cinquantaine et surtout de la manière de conduire son existence.
Entre eux il y a des souvenirs, une femme convoitée par tous les deux et que Viktor a fini par épouser. Ils ont connu deux trajectoires différentes, ils ont adopté deux manières opposées de mener leur vie.
Léon est un baroudeur plutôt silencieux, un humanitaire habitué des conflits et des camps, globe-trotter qui a abandonné femme et enfants. Viktor vit depuis des années en couple, dirige un restaurant, a des valeurs bourgeoises. Leur amitié est faite d'attirance et d'agacement, de rivalité et de flashs d'amour.
Ils passent quelque temps dans un refuge, sur un plateau désertique, puis se dirigent vers un camp de base près de l'Annapurna. A mi-chemin, Viktor renonce. Léon va jusqu'au bout, seul, mais quand il retrouve son ami en ville, c'est... Non, vous savez bien : on ne révèle pas la fin des romans, surtout quand il y a une surprise.
Alain Bagnoud
Source: blog d'Alain Bagnoud
Le Courrier
Amitié au sommet, dans Le Courrier
Viktor et Léon fêtent leurs 50 ans par un séjour au Népal : les deux amis ont pris des chemins divergents, la marche et la solitude devraient leur permettre de se retrouver. Perchés en pleine montagne, ils confrontent leurs idées du bonheur : si Viktor est heureux en ménage et stable sur le plan professionnel, Léon l’éternel voyageur pose en don Juan toujours insatisfait, un rien méprisant de la vie rangée de son ami.
Le fil des jours fait ressurgir leur ancienne rivalité ; le dépassement de soi offert par la marche inspire à Léon une tardive remise en question. Ode à l’amitié, Pokhara du Genevois Serge Bimpage, s’interroge sur le sens de la vie et l’accès au bonheur. Dommage que l’auteur rendre aussi explicite la vision qui sous-tend son propos, frôlant le didactisme : le roman est alourdi par des accents un brin moralisateurs.
Anne Pitteloud
La Liberté
Un grinçant anniversaire, dans La Liberté
Décidément le journaliste genevois poursuit sa quête de l’écriture vérité sur les rapports entre les êtres.
Dans La Reconstitution (qui est rééditée dans la collection L’Aire bleue), il tentait le redoutable exercice de « tout » dire sur son père. Avec son nouveau roman, Pokhara, il envoie deux vieux amis, au mitan de leur vie, fêter leur anniversaire dans les montagnes du Népal.
Une célébration grinçante puisque les hauts sommets du toit du monde vont révéler à Viktor et Léon quelques bribes de vérité sur l’amitié et le sens de la vie. Un récit intelligemment mené, dense et précis, sans fioritures, comme si l’air raréfié du Népal rendait tout discours impossible, mais se prêtait à la concentration sur quelques mots essentiels.
Jacques Sterchi
Le journal du samedi 10 novembre 2007, Radio suisse romande
On en vient au roman que vous nous proposez, on le doit au Genevois Serge Bimpage, auteur de plusieurs récits, essais, biographies et romans. Son titre, c’est Pokhara, une petite ville du Népal d’où partent les ascensions ?
(Geneviève Bridel) C’est ça, et c’est le lieu où se retrouvent deux amis d’enfance, pour fêter leur cinquantième anniversaire, « loin des méchants », comme dit l’un d’eux, Léon. Léon qui est, on va simplifier, le baroudeur qui a tout largué, femme et enfants, en tout cas, qui se veut libre et sans attaches ; son ami Viktor, lui, a réussi à s’échapper pour cette occasion du restaurant qu’il dirige avec sa femme, il revendique son désir de « jeter l’ancre », comme il dit, ce à quoi l’autre lui réplique qu’il a signé son arrêt de mort !
Sur moins de 100 pages, Léon et Viktor vont entamer un trekking, confronter leurs choix de vie et aussi sentir ce que peut et doit être l’amitié. C’est un livre concis, raison pour laquelle il aurait pu se dispenser de la moindre coquille – c’est un message à l’éditeur – et c’est un livre à la fois résistant et fataliste !
Ce qui paraît contradictoire… ou on résiste ou on se résigne, non ? Comment faire les deux à la fois ?
(GB) En acceptant de renoncer pour ne pas être vaincu : autrement dit, en assumant ses faiblesses et ses dépendances, en reconnaissant ce que l’on doit aux autres, mais aussi en gardant vivants et présents à l’esprit les engagements qu’on a pris, les conneries qu’on a faites et en se répétant que ce qui devait arriver arriva, ou arrivera.
Voilà la conciliation de ces deux attitudes qu’on trouve dans le roman de Serge Bimpage, avec une prédominance du fatalisme, tout de même, qui se résume dans cette phrase : « il fallait se faire une raison : l’univers des possibles se rétrécissait. » C’est sans doute la phrase dans laquelle se retrouveront pas mal de quinquagénaires, pour autant qu’ils s’octroient, comme les deux héros de Pokhara, le temps de réfléchir deux minutes à ce qu’ils sont, ce qu’ils font et ce qu’ils veulent.
C’est une sorte de bilan un peu nostalgique, ce livre ?
(GB) Pas nostalgique dans la mesure où la nostalgie viendrait de ce qu’ils refusent le présent et lui préfèrent le passé, ce qui n’est pas le cas. Et puis aucun des deux amis ne larmoie vraiment, même si tous deux gambergent pas mal… pour des hommes ( !) puisqu’ils ont quitté l’action pour la réflexion… D’ailleurs, cette situation extrême qu’ils ont choisie, effort physique, dépaysement, solitude, huis clos, si on peut dire à propos de l’Himalaya, se prête particulièrement à l’introspection.
Disons plutôt que c’est le bilan d’une vieille amitié de plus de 40 ans… avec un constat tardif mais réel sur les soins qu’exige l’amitié et que l’auteur exprime ainsi : « L’amitié contient de l’amour, jamais l’inverse. D’un amour trahi, on se remet, pas d’une amitié disparue ».
A ce stade, il faut peut-être préciser que Pokhara n’est pas un livre macho sur les vertus de l’amitié virile.
Encore une contradiction à relever chez Bimpage, son livre a quelque chose de féminin dans la volonté de faire le point, et de mettre des mots sur des sentiments enfouis et des non-dits, mais l’écriture est assez masculine, je dirais parfois un peu expéditive, on reste parfois sur sa faim, notamment de correspondances plus développées entre cet Himalaya formidable et ce sentiment de vanité qu’éprouvent les deux amis. Le fond prend le pas sur la forme. Ce qui est tout à fait cohérent avec le propos de l’auteur : s’interroger sur ce qui est essentiel, ce qui reste en fin de compte.
Geneviève Bridel
la Tribune de Genève
La route de « Pokhara » serpente à la croisée des destins et de l’amitié, dans la Tribune de Genève
D’une écriture sensible et épurée, Serge Bimpage tisse un récit d’une rare densité
Tendre. Vers le ciel, les sommets, l’autre toujours. Pour Viktor et Léon, qui ont décidé de fêter leurs 50 ans sur les contreforts de l’Annapurna, cette tension assure toute son acuité à la relation qui les unit.
En quête d’appuis, cheminant sur une amitié plus instable qu’il n’y paraît, les deux hommes se sont lancés dans cette escapade comme on s’offre une retraite hors du monde.
C’est bien en amont de Pokhara, là où le quotidien reprend ses droits, que leurs routes ont divergé. Parce que la vie est ainsi faite qu’elle ne laisse guère de choix. On peut y céder à son corps parfois défendant, à l’instar de Viktor, ou prendre la tangente. Abandonnant femme et enfants, Léon a opté pour la rupture, « comme tous les grands hommes ».
Aux yeux de Viktor, ce choix relève d’une fuite en avant qui ne mène nulle part. Et surtout pas vers une illusoire réinvention de soi. Pour lui, Léon se fourvoie. La vraie vie est peut-être ailleurs, mais cet ailleurs n’en est plus un dès lors qu’on l’atteint. « N’était-ce pas à lutter contre sa pesanteur que l’être humain déployait l’essentiel de son existence ? », se demande notamment Viktor.
Le bonheur en question
Sans fioriture, dans une langue fluide et élégante, Serge Bimpage trace les portraits tout en nuance de deux amis au mitan de leur existence. Loin d’être absentes de ce récit aux contours métaphoriques, les femmes en esquissent le douloureux relief.
A l’horizon du périple, c’est moins le bonheur que sa définition la plus juste qui semble motiver la course de Viktor et Léon. Avec, pour finir, ce constat humble et lucide : « La vie est belle du simple bonheur d’être envie. Qui ne réalise pas cette absolue vérité ne vit pas ».
Lionel Chiuch
l'Hebdo
Sélection Payot/L’Hebdo « les meilleurs romans de la rentrée », dans l'Hebdo
Pour leurs 50 ans, deux amis décident de refaire un voyage entrepris il y a dix années, au cœur du Népal. Cette première expédition s’était soldée par un renoncement, celui de Viktor.
Léon ne lui en a pas tenu rigueur. Pour preuve, il lui propose à nouveau ce voyage. Au fil de l’ascension, c’est toute l’amitié entre les deux hommes qui est évoquée, les non-dits du passé ressurgissent et sucitent diverses questions.
L’amitié survit-elle envers et contre tout ? Peut-on pardonner et jusqu’où peut-on aller par amitié ?
Florence Capelli
La Croix
« S’il m’a été donné d’accomplir la grand œuvre de la Croix-Rouge universelle, c’est pour avoir été désigné par le Très-Haut. A cela, je ne puis rien, si ce n’est Lui exprimer mon infinie reconnaissance de m’être trouvé là pour servir Son dessein, dussé-je payer cette élection, pareil au Christ, de la plus insupportable des disgrâces. »
Cette phrase tirée des Mémoires imaginaires d’Henry Dunant résume assez bien la personnalité qui se dégage de cette nouvelle biographie du fondateur de la Croix-Rouge. Profondément croyant, mais aussi mégalomane et terriblement orgueilleux au point de jouer systématiquement les grands seigneurs, quitte à se retrouver sur la paille.
Le Genevois n’apparaît pas aussi philanthrope que son action aurait pu le laisser croire. Il a démarré sa carrière comme homme d’affaires. C’est en cherchant des appuis chez les puissant de son époque (il voue un culte véritable aux têtes couronnées), qu’il rencontre Napoléon III, peu avant la bataille de Solférino.
Et si cette boucherie sera à l’origine de la création de la Croix-Rouge, c’est aussi parce que Henry Dunant, dépité par le refus impérial d’un appui pour son entreprise coloniale, cherchera un dérivatif.
Sa soif inextinguible de reconnaissance exaspère ses contemporains. Justice lui sera finalement rendue, mais au prix d’une très longue traversée du désert qui en fera un homme brisé.
C.R.
Scènes Magazine
Mémoires imaginaires, dans Scènes Magazine
On parle beaucoup d’Henry Dunant en ce début d’année, d’abord avec la pièce Dunant de Michel Beretti présentée à la Comédie au mois de mars et maintenant avec une biographie que lui consacre Serge Bimpage, parue récemment aux éditions Albin Michel. Il faut dire que la destinée de ce personnage si contradictoire offre une matière historique, dramatique et romanesque encore largement inexploitée. En adoptant la forme des mémoires imaginaires, le texte de Serge Bimpage plonge le lecteur dans la réalité intérieure de Dunant.
Habile stratagème littéraire, car le lecteur se trouve d’emblée aux prises avec un « je » qui s’adresse à lui naturellement pour établir une communication directe sur le mode de la confession. On pense immédiatement à Rousseau, à ses obsessions de justification, de réhabilitation. La suite du récit confirme cette impression et le « je » fictif se révèle comme un outil extrêmement efficace pour mieux exprimer la vérité intérieur du personnage. Ainsi une fois admise la substitution, on plonge avec Dunant dans le tourbillon de sa vie.
Serge Bimpage confesse volontiers les motifs qui l’ont amené à ce double « je ». Dès le départ de son projet biographique, l’auteur a acquis la conviction que Dunant, ceci dès sa plus tendre enfance, n’a jamais eu l’occasion de s’expliquer sur les divers échecs et épreuves qui ont jalonné son existence. Un déficit de communication qui s’enracine de façon particulièrement emblématique dans les relations défaillantes qu’il entretient avec un père absent.
Le désir de s’expliquer avec ce dernier sur des sujets familiaux et intimes ou sur des préoccupations liées à son avenir professionnel, à la religion, la politique ou l’économie, se heurte à un mur de silence. Le père vit sa vie du côté de Marseille où il gère des affaires peu rentables et fréquente des femmes, beaucoup de femmes. Les lettres que Dunant fils adresse au père expriment pathétiquement ce besoin. Depuis lors, les déficits explicatifs s’enchaînent, l’un des plus significatifs restant l’impossibilité de s’expliquer publiquement sur la formidable faillite de son projet colonial en Algérie, la Société financière et industrielle des moulins de Mont Djemila, qui mobilisa toute son énergie pendant quinze ans. Cette débâcle le condamne définitivement aux yeux de la bonne société genevoise.
Réappropriation de la parole
Dunant le visionnaire, Dunant le rêveur bâtit plan sur plan, puis les abandonne les uns après les autres parce qu’enlisé dans mille difficultés, alors il s’exile et se mure dans le silence. Il en va ainsi de la plupart de ses entreprises financières et humanitaires (y compris celle de la Croix-Rouge que son rival Gustave Moynier reprend à son compte et mène à son terme). Jamais cependant la parole ne sera donnée à Dunant pour s’expliquer, c’est la raison pour laquelle Serge Bimpage a voulu lui offrir cette opportunité posthume de s’exprimer, à travers le jeu rhétorique des mémoires imaginaires. Ainsi, grâce à cette réappropriation de la parole, nous écoutons la « voix » du Dunant contant ses mésaventures. Une voix littéraire, car les traces de cette parole ne subsistent que sous la forme de l’écriture.
L’auteur à cet égard place d’emblée et métaphoriquement son récit sous cette bannière ; ainsi dès les premières lignes Dunant, âgé de soixante-sept ans, exprime son besoin de dérouler le fil de sa vie pour par l’écriture, projet que, comme tant d’autres, il ne parvient pas à concrétiser lui-même. Usé par la vie, mal conseillé et en proie au délire de persécution, il tente en vain de mettre de l’ordre dans ses idées et les « Mémoires » qu’il a laissées restent un chaos inachevé. L’écriture de son autobiographie ne pouvait donc, dès le départ, que passer par l’entreprise d’un écrivain tiers. Dans un premier temps, ce relais autobiographique passe par Rudolf Müller, un jeune professeur d’histoire dont Dunant s’entiche, mais son inexpérience ruine l’entreprise. C’est Georg Baumgartner, rédacteur en chef à l’Osterschweiz, qui posera le premier jalon de cette rédaction impossible. Le journaliste rédige en effet en 1895 deux articles décisifs sur Dunant dont la presse internationale se fera l’écho et qui le feront sortir du néant de l’oubli.
Le salut par l’écriture
Dans l’une de ses intuitions géniales, Dunant avait pleinement conscience que l’écriture autobiographique serait salvatrice, même si elle devait passer par la main d’un autre. Il l’a d’ailleurs exprimé clairement de son vivant. Serge Bimpage a compris cette nécessité et celle-ci, dans son ouvrage, guide et justifie la parole fictive du protagoniste. La vérité historique n’en demeure pas moins intacte, car la voix imaginaire de Dunant est doublée par la voix de ses écrits. L’auteur cite de très nombreux passages de ses œuvres qui constituent une seconde matière littéraire enchâssée dans la première. Le lecteur découvre alors un espace textuel historique libéré des contraintes du genre, ce qui pourrait, on le conçoit, irriter l’esprit de scientifique des historiens. Mais le projet biographique de Serge Bimpage se situe sur un autre versant que celui de la quête historique stricto sensu. L’ambition de cet ouvrage est à rechercher dans le désir de restitution de cette « voix » jamais entendue, dans la compréhension de la réalité psycho affective d’un homme au caractère marqué tant par la lucidité que par la folie.
Au terme de ce récit, le mystère des ambivalences de Dunant demeure entier, notamment lorsqu’on découvre les magnifiques pages qu’il rédige à la fin de sa vie sur le pacifisme, la guerre, le militarisme, le capitalisme ou le féminisme. Mais, en même temps, ses paranoïas de persécution, d’isolement, de foi s’aggravent. Dunant, délaissant l’écriture, se met alors à peindre (dans un style d’art brut), des scènes bibliques retraçant l’histoire de l’humanité, de la Création jusqu’à l’Apocalypse. Un message divin selon lui : « J’utilise beaucoup le rouge… C’est la bataille de Solférino, le sang versé sur le champ de bataille, le rouge de la croix, le rouge du mal sur le blanc de la pureté, la tache de la colombe. ».
Si la voie autobiographique s’accomplit quelque part grâce au travail créatif de Serge Bimpage, la voie biographique, on le comprend, représente un vaste chantier. Jusqu’à ce jour, en effet, il n’existe toujours pas de biographie décisive sur Dunant, même si d’importantes recherches ont été menées, notamment par la Société HenryDunant de Genève. Il semble que la vie de Dunant se soit désormais figée dans une icône en forme de Croix-Rouge et l’on peut se demander si l’histoire est en mesure de la profaner, le cas échéant la fiction y pourvoira.
Françoise-Hélène Brou
Choisir
Moi, Henry Dunant, j’ai rêvé le monde, dans Choisir
Serge Bimpage, « saisi sans la moindre raison rationnelle » par le mystère Henry Dunant, par la nécessité de donner voix à son cri « lancé à l’humanité souffrante », nous dit sa découverte d’un homme. Un homme à la personnalité complexe, « intelligent mais naïf, ambitieux mais immature, séducteur mais maladroit, calculateur mais pas stratège, snob mais non prétentieux, cultivé mais autodidacte, effacé mais narcissique, attiré par l’argent mais généreux. Tout est dit.
En quelque 270 pages, Serge Bimpage « revit » Henry Dunant, explorant sa personnalité, ses enthousiasmes, ses exécrations, ses triomphes, ses échecs, le chrétien engagé, l’homme d’affaires, le brillant réalisateur, le failli honteux, l’homme de la cour, le clochard. L’intérêt ne faiblit jamais : de la rue des Granges à Saint-Gervais, de la petite Genève aux grands conflits européens, du pasteur Gaussen, animateur du Réveil, à Napoléon III, successeur de Charlemagne, des moulins algériens à Solférino, de la fondation de l’Alliance universelle des Unions chrétiennes de jeunes gens à la naissance de la Croix-Rouge, c’est toute la diversité d’une époque foisonnante évoquée au fils des pages.
Et l’auteur réussit à nous faire pénétrer au plus profond de la psychologie torturée d’un homme passant de l’euphorie à la dépression, des idéaux les plus élevés au « besoin d’appartenir à la classe patricienne ». Un homme qui se passionne pour la cause anti-esclavagiste et qui fait sienne un dit de Mme Girardin : « L’égalité, c’est l’utopie des indignes. » Un homme enfin qui s’enorgueillit de fréquenter les grands de ce monde et passe de longues années de sa vie dans l’obscurité et la misère.
Serge Bimpage ajoute à ces mémoires frémissantes, avec une copieuse bibliographie, deux utiles chronologies : celle de la vie d’Henry Dunant et celle des principaux événement de son époque. Dans sa postface, il interpelle, en deux lignes, trois générations de Genevois : « mort d’Henry Dunant en 1910 » ; « érection de son buste à Genève en 1980 ». Pourquoi tant d’années entre ces deux dates ?
Georges Tracewski
Lectures Magazine
Au chevet d’Henry Dunant, dans Lectures Magazine
Tout le monde sait aujourd’hui qu’Henry Dunant fut le fondateur de la Croix-Rouge. On sait moins l’énergie qu’il dépensa pour mettre sur pied son projet humanitaire qui ne nous ferait plus jamais voir les guerres de la même façon.
Mais ce qu’on ignore, c’est la mise à l’écart dont il fut victime avant que le Nobel de la Paix vienne, en 1901, célébrer ses acquis.
Grâce à Serge Bimpage qui a effectué un formidable travail d’historien, on peut retrouver l’homme isolé, en proie au doute. L’auteur a imaginé un dialogue avec un journaliste, qui nous donne l’impression de partager l’intimité de ce visionnaire hors du commun.
On côtoie, avec lui, les familles patriciennes genevoises, on croise Moynier ou Maunoir, mais aussi Victor Hugo, entre Napoléon et les banquiers privés genevois. Le ton est personnel, tantôt allègre, tantôt impertinent.
Le talent d’écriture de Serge Bimpage redonne vie au grand homme.
A dévorer comme un roman.
Serge Bimpage
Le Courrier
Moi, Henry Dunant, j’ai rêvé le monde, dans Le Courrier
Il arrive à point nommé, le livre de Serge Bimpage chroniqueur à la Tribune de Genève et auteur de plusieurs ouvrages empreints de mémoire, historique ou familiale. A l’heure où, en Irak, les armes font taire la diplomatie et craindre le pire au plan humanitaire, ces « mémoires imaginaires » d’Henry Dunant jettent une lumière inédite sur l’engagement têtu du fondateur du CICR. Cancre à l’école, homme d’affaire malheureux en Algérie, Dunant subit un choc le 24 juin 1859 lors de la bataille de Solferino, qui oppose Français et Piémontais.
Venu assister au « spectacle » de la guerre, il en conçoit au contraire une profonde aversion. Après avoir improvisé des soins d’urgences, pour les milliers de blessés laissés à l’abandon, Dunant le philanthrope se fait visionnaire : auteur en 1862 d’un vibrant plaidoyer humanitaire - Un souvenir de Solferino - il fonde la Croix-Rouge internationale en 1875, imagine les Conventions de Genève et reçoit en 1901 le tout premier Prix Nobel de la Paix. Dunant achève pourtant sa vie ruiné et malade dans un hôpital de Heiden, Appenzell, où il meurt le 30 octobre 1910, à 82 ans.
C’est à Heiden que Serge Bimpage fait débuter son livre, en 1867, par la rencontre entre le vieux sage et Georg Baumberger, un journaliste local. Moi, Henry Dunant, j’ai rêvé le monde est le récit à la première personne du parcours de Dunant, entre anecdotes personnelles et déclamations pontifiantes. L’intérêt est inégal, même si l’affection évidente de Serge Bimpage pour son objet et la verve idéaliste de celui-ci font surgir les images au fil des pages.
Comment rester insensible au pacifisme mêlé de pessimisme d’un Dunant qui, au soir de sa vie, rédige un pamphlet antimilitariste méconnu, L’Avenir sanglant, et prononce sous la plume de Serge Bimpage des paroles pour le moins prophétiques : « Notre civilisation tant vantée est désormais traversée par la barbarie dont le spectre m’est rien moins que la guerre universelle. »
Roderic Mounir
Construire
DUNANT et nous, dans Construire
Notre confrère Serge Bimpage s’est glissé dans la peau d’Henry Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge, pour nous raconter son étonnant parcours. Il publie « Moi, Henry Dunant, j’ai rêvé le monde ».
Un livre de chevet, au style attachant, le tout dernier du grand journaliste, écrivain, essayiste, Serge Bimpage :Moi, Henry Dunant, j’ai rêvé le monde, Editions Albin Michel. Que de recherches, de documentation, pour nous relater l’étonnant parcours du fondateur de la Croix-Rouge Internationale, (1818-1910), Prix Nobel de la Paix en 1901, qui après avoir rêvé un autre monde humanitaire, finit sa vie blessé, ruiné, oublié de tous.
L’auteur qui s’est glissé dans la peau de cette figure emblématique, fait parler dans son livre Dunant lui-même, à la première personne. C’est ce destin hors du commun que nous restitue cette biographie unique, que le lecteur suit avec passion. Un livre instructif, dans l’air du temps…
Jean-François Duval
Prestige
Henry Dunant vu par Serge Bimpage, dans Prestige
Un livre de chevet, au style attachant, le tout dernier du grand journaliste, écrivain, essayiste, Serge Bimpage :Moi, Henry Dunant, j’ai rêvé le monde, Editions Albin Michel.
Que de recherches, de documentation, pour nous relater l’étonnant parcours du fondateur de la Croix-Rouge Internationale, (1818-1910), Prix Nobel de la Paix en 1901, qui après avoir rêvé un autre monde humanitaire, finit sa vie blessé, ruiné, oublié de tous.
L’auteur qui s’est glissé dans la peau de cette figure emblématique, fait parler dans son livre Dunant lui-même, à la première personne. C’est ce destin hors du commun que nous restitue cette biographie unique, que le lecteur suit avec passion. Un livre instructif, dans l’air du temps…
Salwa D. Tohmé
la Tribune de Genève
Serge Bimpage décroche le Prix de la Société littéraire, dans la Tribune de Genève
Le journaliste et écrivain est récompensé pour sa biographie du fondateur de la Croix-Rouge.
En mai sortait Moi, Henry Dunant, j’ai rêvé le monde de Serge Bimpage. Il s’agissait d’une biographie, écrite à la première personne, du fondateur de la Croix-Rouge. Autant dire que les faits, tous vérifiés, subissaient une interprétation sinon romanesque du moins… interprétative.
Publié à Paris par Albin Michel, le livre vient d’obtenir le Prix de la Société littéraire de Genève. Il sera remis à notre collaborateur le 22 octobre dans les somptueux salons que l’association, fondée en 1815, occupe au 19 de la Corraterie. « Je suis très flatté de ce choix », explique le lauréat. « Une vénérable société composée de vénérables distingue un sujet longtemps resté polémique à Genève. Il aura fallu un siècle pour que la ville digère les initiatives d’un homme qui la dérangeait. »
Ce sont les jurés qui font eux-mêmes leur marché. Ils choisissent les différents ouvrages, parmi lesquels un seul se verra peut-être couronné. Le prix n’a pas été remis en 2002. Cette année, 22 titres se trouvaient en lice. « J’ai été invité par le jury. Il estimait qu’il s’agissait d’une bonne cuvée. Je me retrouve en compétition avec Catherine Safonoff. »
L’Henry Dunant s’est vu bien accueilli dans la presse. « Je n’aurais jamais espéré autant d’articles, de La Croix à La Quinzaine littéraire. » Côté ventes, tout reste en revanche flou. Il faut entre huit mois et un an pour les comptes. « Albin Michel m’a cependant demandé quelles corrections j’aurais apporté pour une réédition. » En attendant, Serge Bimpage écrit. Ce sera cette fois de la fiction pure.
Etienne Dumont
L'Hebdo
La légende de Dunant, dans L’Hebdo
Qui était vraiment le fondateur de la Croix-Rouge ? Le journaliste genevois Serge Bimpage a mené l’enquête. Résultat confondant.
On a tous en tête l’image d’Henry Dunant assistant à la bataille de Solferino où agonisent soldats français, italiens et autrichiens et décidant derechef de créer une organisation qui soulagerait les blessés. Dunant écrit « Un souvenir de Solferino », qui aura un énorme retentissement. La Croix-Rouge est fondée en 1863, les Conventions de Genève élaborées. Pourquoi diable, alors, Dunant se trouve-t-il en 1895 dans une petite ville d’eau appenzelloise, ruiné, déchu, tenu pour fou ? Un autre genevois, le journaliste et écrivain Serge Bimpage, a mené l’enquête. « Moi, Henry Dunant, j’ai rêvé le monde », est une courageuse autobiographie imaginaire. A travers un engagement très personnel de l’auteur, Dunant raconte ce que fut sa vie, loin de l’image d’Epinal retenue par la postérité.
Le livre se situe en 1895. Dunant rencontre Georg Baumberger, reporter à „Die Osterschweiz“. Baumberger va sortir Dunant de l’oubli où il se trouve depuis des années, « fuyant l’humanité ». « J’ai trop exigé d’elle »,écrit Bimpage-Dunant, d’après les Mémoires que Dunant écrivait au moment de mourir. Son esprit crie justice, sa paranoïa dénonce « la splendide indifférence de l’humanité à l’égard de ce que j’ai fait pour elle. » Cinq ans après, en 1901, il reçoit le premier Nobel de la paix. Il meurt en 1910.
C’est une image de Dunant étrange qui se dégage de ces « Mémoires » fictifs. Le personnage est torturé, prétentieux, amer, exigeant, colérique, insatisfait. S’il va à Solferino, c’est surtout pour que l’empereur donne un coup de pouce à ses affaires.
« Il y a un gouffre entre l’image- l’icône que l’on forge d’une personnalité et – sa réalité de chair, j’ai payé de mon exil pour le savoir. »
Captivant.
Isabelle Falconnier
Le Temps
La trattoria della Fontana, dans Le Temps
C’est dans l’espace réduit d’une cuisine-laboratoire genevoise, rue Dancet, que Serge Bimpage a maintes fois observé la Nonna, en fait sa belle-mère Irma, cuisiner un de ces solides repas à la piémontaise pour douze personnes qui lui demandent une journée de travail. Muette devant son fourneau, complètement concentrée sur ce qu’elle fait, ses gestes sont alors plus parlants que lorsqu’elle commente tel fait divers en le ponctuant de comunque ! ou de ma che roba !
C’est pourtant dans sa cuisine qu’elle a évoqué ce jour lointain de l’été 1943 où les partisans ont débarqué à Rivalba dans la trattoria de ses parents, en leur demandant de préparer, au lieu du risotto e tajarin, le veau et les pommes de terre qu’ils avaient apportés. Elle avait 18 ans et c’est ce jour-là qu’elle a rencontré son futur mari Giuseppe, membre du PCI et futur délégué des syndicats italiens auprès du Conseil économique et social de Genève. Comme la cause de la paix pour Giuseppe, la cuisine aura été la vie d’Irma : le prouvent la quarantaine de savoureuses recettes finales, dont le temps de préparation semble parfois légèrement surévalué (ainsi pour les pêches farcies).
Isabelle Martin
l’Emilie
La trattoria della Fontana, dans l’Emilie
« La guerre. Quel mot bizarre : totalement abstrait » avoue la cuisinière, l’héroïne de cet ouvrage. Mais contrairement à ce que cette phrase affirme, le récit de l’année 1943 et de la guerre d’Irma n’est pas hors du monde. Souvenirs de nourritures, d’odeurs et d’êtres s’entremêlent pour nous faire toucher à la vie d’une petite trattoria de village et de ses propriétaires pris sous les feux de luttes fratricides. Il est midi, c’est un beau jour de 1943. L’auberge est pleine et la cuisinière propose risotto et tajarin, la spécialité de la maison.
Mais les partisans préfèrent leur propre cuisine et lui demandent de préparer les pommes de terre et le veau qu’ils ont apportés. Irma la fille du patron sert à table, rencontre Giuseppe, un intellectuel : « d’abord enseignant primaire à Turin, puis membre du Parti communiste italien et journaliste à l’Unità… avant d’être élu membre de la Commission des droits de l’Homme (sic) au Bureau International du travail ». Et la trattoria de devenir ce qu’elle a partout été : le lieu de toutes les rencontres. Or, « dans le grand bouillonnement de la marmite italienne brassent d’étranges ingrédients. Ils ont pour nom communisme, fascisme, monarchisme, christianisme » et tous et toutes tomberont dans la marmite.
Irma, comme son gendre Serge, savent raconter ce qu’est la guerre pour les gens « sans qualité », comment on passe insensiblement de la cuisine à la résistance, et comment une fois la guerre finie la vie ordinaire reprend son cours. Et si le récit est captivant, plein de tendresse et d’amour, si les recettes mettent l’eau à la bouche, l’une des qualités de ce récit – et non des moindres - , c’est de nous donner envie de nous rendre dans cette cuisine rue Dancet à Genève pour y continuer avec l’auteur et la Nonna cette conversation et initiation à la cuisine italienne.
Thérèse Moreau
La Tribune de Genève
La trattoria della fontana, dans la Tribune de Genève
Entrons dans l’univers culinaire de la Nonna, cuisinière de passion à la trattoria della Fontana, à Rivalba, dans la campagne turinoise. Etablissement tenu par ses parents, le patron et la Signora. Nous sommes au cœur de la guerre. Partisans et chemises noires s’affrontent alors que la Nonna, Irma de son prénom, concocte avec attention la sauce du vitello tonato, mayonnaise agrémentée de thon, anchois et câpres, finement écrasés pour en faire une crème onctueuse recouvrant les fines tranches d’un veau de lait longuement poché.
Le fils de la maison, frère d’Irma, Attilio, est prisonnier quelque part en Allemagne. Irma sa sœur se désole, mais rencontre un jour de vendange Guiseppe. Partisan, chargé de la communication dans un réseau, réfugié dans un vieille bâtisse dans les collines avoisinantes. Serge Bimpage, nous raconte cette histoire d’amour, marquée par des drames, des arrestations arbitraires, la fermeture de la trattoria par un patron excédé par l’absence de son fils.
Et le retour de ce dernier, la fin de la guerre, le mariage heureux de la Nonna et Giuseppe. L’auteur, journaliste à la Tribune de Genève, n’a rien romancé. Cette histoire est celle de ses beaux-parents qui immigreront un jour en Suisse, s’installeront à la rue Dancet et jouiront d’une vie heureuse marquée de façon indélébile par les drames du passé, parfois sous-entendus, jamais évoqués…
Irma a expliqué à Serge Bimpage les secrets culinaires de la Trattoria della Fontana. Une petite cinquantaine de recettes familiales, simples, savoureuses, vraies… On y découvre les mystères du risotto aux poivrons ou au barolo, celle de la polenta parfumée à la coriandre, muscade et girofle. Sans oublier le sabayon au marsala et amaretto di Saronno.
Alain Giroud
Femina
Nonna, dans Femina
Le dernier livre du journaliste écrivain genevois Serge Bimpage, La trattoria della Fontana, ravira les lecteurs et amateurs de bonne chère. Publié dans la collection La Cuisine de mes souvenirs chez Metropolis, cet opuscule bleu, dont la couverture est une aquarelle de l’auteur, renferme des trésors dignes d’être testés, goûtés, partagés… et lus ! Car ici l’histoire et l’art culinaire s’entremêlent : à Rivalba, petit village proche de Turin, la belle-mère de Bimpage Nonna Irma, se rappelle bien des années plus tard, l’époque de la guerre.
Fille de l’aubergiste, elle servait partisans et fascistes… pas le choix. La violence, la peur, les disparitions, elle a tout vécu. Puis elle a rencontré Giuseppe, un partisan, qu’elle devait suivre plus tard à l’étranger où l’appelait son travail. Oh, il a fallu du temps à Bimpage pour la faire parler, la Nonna. Elle préférait le mutisme retranchée dans sa cuisine, toute à ses casseroles où mitonnaient, au fils des ans, les recettes familiales issues du Piémont. Celles-là mêmes qu’elle offre au lecteur dans la deuxième partie de l’ouvrage, plus succulentes les unes que les autres et si typiques de cette cuisine italienne respectueuse des aliments de base, jamais noyés dans les sauces et les crèmes à la française. Un art culinaire tellement méditerranéen, qui de déploie entre soleil et subtiles efluves.
Le charme de l’ouvrage tient d’abord à la plume du journaliste, légère et chaleureuse. Qu’il raconte les drames de la saga familiale ou les moments heureux, il sait jouer du verbe qui oscille entre l’opéra dramatique et le simple conte de la vie ordinaire. Les images sont colorées, le lecteur lui-même arpente les rues de Rivalba, il pousse la porte de la trattoria et s’entend commander le risotto ai tartufi. Car il n’est nul besoin de long roman pour séduire le lecteur et provoquer son émotion ; en 58 pages, Bimpage crée des liens et dévoile un pays qui souffre. Le reste appartient à la Nonna : 58 autres pages de belle et bonne cuisine. Le livre se termine avec quelques mots concernant les crus à ne pas rater : l’envoûtant Barolo, le Barbera corsé… et l’incontournable grappa…
Bernadette Richard
Scènes Magazine
Les recettes de la Nonna Irma dans Scènes Magazine
Les recettes de la Nonna Irma
Dernier ouvrage en date, on doit La Trattoria della Fontana à la plume inspirée de Serge Bimpage, écrivain journaliste. Avec une saveur unique (qui n’étonnera pas ceux qui lisent ses chroniques dans La Tribune de Genève), Bimpage retrace ici la figure émouvante de Nonna Irma dont le père tenait une auberge dans le petit village de Rivalba, proche de Turin, pendant la dernière guerre. Pour cette femme de caractère, la cuisine était à la fois un plaisir et un sacerdoce.
Ses gestes, qui sont « la mémoire muette du temps », Bimpage les observe et s’en imprègne, comme il s’imprègne des paroles de la cuisinière qui, dès qu’elle s’éloigne des fourneaux, devient intarissable. Partager et survivre, se taire et écouter ; voilà l’unique manière de traverser l’horreur fasciste, les sautes d’humeur ou les menaces des « chemises noires » qui viennent régulièrement inspecter l’auberge. C’est un partisan, Guiseppe, amateur silencieux de sa cuisine, par ailleurs communiste et journaliste à l’Unità, qui tombera amoureux d’elle, l’emmènera à Vienne, puis à Genève, où le couple s’établira et aura une fille (qui, à son tour, épousera un journaliste, un certain Serge Bimpage…). On le voit : en revisitant le passé, Bimpage explore aussi sa propre histoire, comme dans La Reconstitution, où il parlait si bien de son père.
Ce livre savoureux est accompagné – comme tous les livres de cette collection – de 44 recettes originales, recueillies bien sûr auprès de Nonna Irma. Pour en avoir testé plusieurs (comme celle des oignons farcis et des bolets panés à la farine de maïs), je peux vous dire qu’elles sont irrésistibles !
Jean-Michel Olivier
Le Chênois
La trattoria della Fontana, dans Le Chênois
Imaginons l’auteur tapi dans un coin de la cuisine de sa belle-mère, observant la magie du rituel; les oignons qui blondissent, les poivrons rouges ou jaunes que l’on pèle - les verts sont rebelles -, les filets d’anchois écrasés. Il lorgne peut-être avec espoir une truffe blanche du Piémont dont on râpera quelques bribes sur un plat pour le magnifier. Il est gourmand et gourmet, ce gendre admiratif, mais ses vues ne sont pas seulement culinaires. Il écoute, guette le moment où Irma, sans quitter son fourneau, égrènera ses souvenirs.
Toute jeunette, pendant la guerre, elle aidait ses parents qui tenaient la trattoria della Fontana à Rivalba, près de Turin. Les clients, partisans ou fascistes ont tous un estomac en commun. Il faut savoir se taire, supporter les fanfaronnades, attendre de voir ce qui sortira du « grand bouillonnement de la marmite italienne ». Irma tombe amoureuse d’un résistant; elle aura toute la vie pour lui mitonner des petits plats.
Une belle histoire vraie, ce qui n’est pas si courant, suivie de 44 recettes piémontaises.
Liliane Roussy
La liberté
Le Piémont de la belle-mère, dans La liberté
Souvenirs. Parce qu’une cuisinière du Piémont a eu pour gendre un écrivain, son portrait est immortalisé. D’abord Serge Bimpage regarde avec un sourire un peu moqueur cette femme pour qui la cuisine est une chose si sérieuse. Puis vient le respect pour l’artisane tout entière vouée à sa tâche.
Cette évocation est à la fois gourmande et historique puisque Serge Bimpage évoque cette terrible époque de la guerre où l’aubergiste de Rivalba nourrissait les partisans. Sa fille Irma travaille alors dans la trattoria de ses parents. C’est elle qui va devenir Nonna, quelques décennies plus tard, à Genève. Un jour qu’elle ne cuisine pas (elle est aux fourneaux toute une journée ou pas du tout !) et qu’elle est décidée à parler, son gendre recueille le récit d’une vie âpre et gaie, où tout le monde a toujours faim, où la cuisine est donc la grande affaire.
Suivent quelques recettes rustiques (par les produits) autant que raffinées (elles exigent des heures de préparation). En français bien sûr, mais Bimpage a eu la coquetterie de laisser les noms en dialecte piémontais. Ce qui donne un avant-goût très appétissant.
E.W.I
la Tribune de Genève
Le Piémont de la belle-mère, dans La liberté
Après la guerre, les présidents, les rois ou les stars ne manquaient pas de faire un passage en terre helvétique, pour des vacances ou une rencontre officielle. Un livre, alliant photographies et textes, présente une quarantaine de ces personnages en visite.
Les photographies de Jean-Pierre Grisel révèlent avec doigté la complexité d’un instant. Les textes de Serge Bimpage exploitent judicieusement ce regard révélateur. « je n’ai fait que reprendre au plan du texte la démarche du photographe », explique l’écrivain, qui est aussi journaliste. « Un objet, une position ou un regard révèlent des impressions. » Cette superposition de faits historiques et d’émotions instantanées donne au livre sa légèreté, rendant sa lecture passionnante pour qui se penche sur l’après-guerre.
Xavier Farinelli
Le littéraire, N° 13/14
Comme dans un cauchemar, le roman s’ouvre par l’arrestation brutale de l’héroïne, Sonia Stiller, prétendument terroriste, et qui ne cesse de répéter : « je ne suis pas celle que vous croyez… »
S’agit-il de Sonia Stiller ou bien de Sonia Kaufmann ? Le doute saisit le lecteur au fur et à mesure que l’intrigue se complexifie, mêlant l’étrangeté du savoir scientifique au suspens du roman policier sans exclure pour autant l’amour, la tendresse filiale ou l’amitié.
Sonia, jeune femme de 25 ans, de la génération des squats, aime un journaliste, d’investigation bien sûr, Max Wolf, vieux soixante-huitard désabusé et pince-sans-rire, dont la mort bouscule tout l’échafaudage. Les différents personnages de ce roman haletant et sourdement inquiétant permettent à l’auteur, de manière originale, d’interroger les notions d’identité, d’attachement et d’abandon, mais aussi la notion d’hérédité à travers celle d’empreinte génétique, et la dimension de contrôle social qui nous renvoie à la fameuse affaire des fiches. Comment se construit notre enfermement, de ces contraintes à la fois biologiques, sociales et affectives ?
Si Daniel de Roulet, dans Double (1998), racontait sa propre vie sous forme d’enquête, à partir de son dossier de police, Serge Bimpage, lui, plonge délibérément dans la fiction pour brouiller les pistes dans ce roman ambitieux, qui n’atteint pas la densité et la profondeur du Stiller, mais garde sans cesse en éveil la curiosité du lecteur. L’auteur, pour cet excellent troisième roman, a trouvé une manière subtile et ironique de réfléchir sur le monde moderne et notre identité helvétique éclatée et vacillante.
Claude-Anne Borgeaud
Construire
Sonia ou l’empreinte de l’amour, dans Construire
Salut les auteurs romands !
Sonia ou l’empreinte de l’amour ? Cela tient du polar, mais c’est aussi plein d’une bonne humeur dynamique et drolatique. Bimpage envoie paître le beau style et s’amuse. Il y a du ton, une allégresse, une rapidité, une légèreté. C’est aussi que son héroïne-narratrice est une « gamine » de 25 ans qui porte des bas résille et des bottines, ambitionne d’aller étudier la peinture à la Whitney School de New York, et se présente comme ça : « Moi, c’est Sonia. Pas de carte de visite. Un piercing sur la langue, une cicatrice sous la joue, vierge d’amour vrai, et fatiguée. »
Il lui arrive quantité de péripéties, à elle ainsi qu’à Max, le journaliste quinquagénaire resté attirant, et à ses potes du squat : Assaad et Motus, le petit aveugle qui voit loin… Une bande sympa et débrouille, qui vous réconcilie avec Genève, sa cathédrale Saint-Pierre « à la fierté contrite », son quartier « bâtard » de la Jonction et son Salève « comme affecté d’eczéma ». C’est bien vu, non ? Quant à l’intrigue ? Tout tourne autour d’un labo d’analyse côté hôpital. Une affaire d’empreintes génétiques… problèmes d’identité… atteinte à la sécurité de l’Etat…
Jean-François Duval
Scène Magazine
Sonia ou l’empreinte de l’amour, dans Scènes Magazine
Polar métaphysique
Méfiez-vous de Serge Bimpage ! Ce diable d’homme, que les lecteurs de La tribune de Genève connaissent bien, a plus d’un tour dans son sac. Enquêteur, reporter au long cours, passionné de sciences humaines, il nous livre aujourd’hui trois autres facettes de son talent.
Un polar haletant, tout d’abord, Sonia ou l’empreinte de l’amour, qui s’inscrit dans la lignée des enquêtes métaphysiques d’un Dürrenmatt ou d’un frisch ; un magnifique livre d’images ensuite, Les visiteurs de la Suisse (1945-1965) inspiré par les photographies de Jean-Pierre Grisel ; un recueil de portraits, enfin, dédié à Michel Baettig (l’ami aux multiples talents et à l’énergie inépuisable) qui permet de faire mieux connaissance avec diverses personnalités genevoises (de l’artiste Marc Jurt au comédien Jacques Michel, en passant par Frank Fredenrich, fondateur de Scènes Magazine).
Une double identité
Sonia Stiller ou Sonia Kaufmann ? Le roman de Bimpage s’ouvre sur une arrestation, qui pourrait être un gag, mais aussi une terrible méprise. Est-ce bien elle qu’on cherche ? Est-ce bien elle qu’on arrête ? Sonia au double visage, « côté diurne, c’est un mariage de soleil et d’hortensias ; côté nocturne, l’atmosphère ouatée du songe ». Sonia qui, peu à peu, s’est construit une planète, comme le Petit Prince, qui n’appartient qu’à elle, et que personne ne lui prendra…
Mais impossible, bien sûr, de fuir le monde, même en vivant dans ses marges (Sonia vit dans une communauté de squatters dont Bimpage restitue bien le charme et les contradictions). La société rattrape toujours ceux qui rêvent de lui échapper. Bien malgré elle (mais le hasard, surtout dans les romans policiers, n’existe pas) la jeune femme va se trouver mêlée à une affaire qui la dépasse, et va bouleverser sa vie.
C’est Max, d’abord, un journaliste un brin désabusé, qui vient l’interviewer au squatt, Max dont elle tombe amoureuse et que bientôt, dans d’obscures circonstances, on trouvera « suicidé » chez lui. Sonia va alors reprendre son enquête, à la fois difficile et dangereuse, qui la mènera dans les milieux médicaux et politiques.
De quelle affaire s’agit-il ? Trouvant une place dans un laboratoire d’analyse génétique, Sonia pourra enfin découvrir le secret (mortel) de Max : un réseau de surveillance intime des individus (c’est le rêve du Rhino, Big Brother de la police genevoise) reposant sur l’analyse génétique de chaque citoyen, dont les caractéristiques (à la fois physiques et psychiques) sont fichées ad aeternam.
Comme le hasard n’existe pas, la belle Sonia, mettant au jour un important trafic d’empreintes génétiques, découvrira également le secret de son nom – c’est-à-dire de son père. Alors Sonia Kauffmann ou bien Stiller ? Il faut lire le polar haletant, plein de surprises, d’inventions drôles et de saillies, de Serge Bimpage pour connaître le fin mot de l’histoire. L’enquête est rondement menée et cette empreinte de l’amour ouvre sur des abîmes métaphysiques (l’identité, le destin, le faux secret médical).
Jean-Michel Olivier
Coopération
La fabuleuse histoire, dans Coopération
« Sonia ou l’empreinte de l’amour » est un fameux roman. A dévorer d’un trait, sous l’œil de Big Brother…
Autant vous dire qu’en ces pages vous voilà parti pour un grand voyage. Et pour un sacré monde qui palpite dans le temps conté de Sonia ou l’empreinte de l’amour, le premier roman de Serge Bimpage. Un roman. Tonique. Déroutant. Avec du suspense comme dans un thriller (il en a la vive et ironique allure) dont le récit vous emmène par meurtres, squat, laboratoire d’analyse et autres nuits prises en filature dans les très malignes embrouilles des fiches génétiques. Et du secret d’Etat.
Mais dans ce temps que fait remonter Sonia, Sonia l’insoumise, l’énigmatique, Sonia qui peint, qui aime, Sonia qui se risque et qui elle-même découvre son histoire, dans les cahiers qu’elle écrit en prison, c’est aussi une vaste quête, initiatique, que l’on traverse en ce roman. Où l’on est dès l’abord embarqué dans une manière de cauchemar, mais diurne et très éveillé : l’arrestation, façon brutale et sans appel, de Sonia elle-même.
Sonia Kaufmann ou Sonia Stiller ? « Je ne suis pas celle que vous croyez… », dira-t-elle, en un premier écho de la phrase d’Aragon placée à l’entrée de ce bouillonnant livre : « Quel est donc celui que l’on prend pour moi ? »
Car cette question de l’identité est continûment à l’œuvre dans le roman de Serge Bimpage. Et non seulement dans la trame immédiate du récit qui met en scène, dans la ville (un Genève aux allures inédites), l’ombre persistante de Big Brother. Mais encore, et dans d’autres strates du récit, l’identité passe par le questionnement de la peinture. Et celui de la littérature, en un vaste réseau de citations. La question de savoir qui nous sommes est ainsi liée à celle de la parole qui dans son mouvement nous définit. La fable de Sonia, écrivant…
Jean-Dominique Humbert
Le Passe-Muraille
« Ma mère, mes deux demi-sœurs, le beau-frère et moi serrés au premier banc de l’immense temple désert ». On aura compris que Serge Bimpage, responsable de la rubrique « Culture & Société » à la Tribune de Genève, n’est pas en train de brosser le portrait d’une célébrité. Non, il s’agit de son père, un homme enterré sans pompes, entouré de sa seule petite famille. Enterrement d’un individualiste qui vivait retranché dans son foyer et dont l’horizon social ne dépassait pas celui de la clientèle de son petit commerce de tapissier-décorateur. Un artisan acharné au travail. Un homme sans histoires, selon la formule aussi répandue que mensongère.
Il n’y a pas de vie sans histoire(s), sans conflits, sans douleur, même et peut-être surtout lorsqu’un individu tait son passé difficile au nom d’un présent d’harmonie. Par petites touches agencées par le travail et les associations spontannées de la mémoire, alternant sans souci chronologique images du père, souvenirs et réflexions nourries par ces récurrences, Bimpage écarte peu à peu les brumes enveloppant la biographie paternelle. Nous ne sommes pas dans le registre du règlement de comptes ni dans l’élaboration du portrait édifiant. Dans une telle démarche traçant sa ligne entre le désir de dire et la retenue dictée par une grande pudeur, l’enjeu ne se limite pas au seul sujet, le père, mais s’étend aussi au fils narrateur. L’un ne peut rien révéler de l’autre sans se dévoiler lui-même.
Cette ambiguïté berce ce petit livre d’une musique sensible. Comme Bimpage père, Bimpage fils n’élève jamais la voix, si bien que les qualités qui rendent ce portrait attachant, dans son refus de l’exhibitionnisme intime, en tracent aussi les limites. Soumis aux méandres d’une mémoire enfantine activée, Serge Bimpage se contrôle comme il nous dit si bien que son père ne cessait de se contrôler. Parfois une phrase plus audacieuse lui échappe qui nous fait littéralement sentir le père par « l’abjecte et pourtant délicieuse odeur des cabinets après son passage ». Mais si le fils avait une raison de se plaindre de son père, ce ne serait pas de ce désagrément olfactif, ni d’une autorité exercée avec excès, ce serait seulement de l’inexistence du conflit.
Dans cette reconstruction de l’image paternelle, on est aussi frappé de l’évanescence de la figure maternelle, laquelle n’apparaît qu’en faire-valoir, épouse sans humeurs et presque sans corps. Né alors que son père avait 50 ans après son remariage avec une femme de trente ans sa cadette, l’auteur a toujours vu un vieux dans son vieux, surpris de le voir rajeunir à mesure que les années passaient. Ce père « avait quelque chose d’irréprochable ». Où se situe donc la difficulté ? Non pas tant chez le père, mais dans le silence sur la vie de l’homme avant le père. C’est dans cette zone mystérieuse que le fils se met en quête. Il découvre alors avec précision ce qu’il connaissait de manière allusive, une vie ponctuée de drames et de malheurs. Le fils peut alors nommer le malheur et tirer de l’ombre une part de destin qui fait de son père une sorte de rescapé formidablement optimiste pour qui la vie commence à 50 ans.
Le portrait de Bimpage dit à quel point la vie qui nous malmène peut être aussi généreuse, de père en fils.
Jean-Bernard Vuillème
L’Hebdo
Un passé à reconstruire, dans L’Hebdo
« Il n’y a pas de bon père, c’est la règle, écrivait Jean-Paul Sartre en se félicitant de n’avoir pas connu le sien. Tout lien de paternité se ramènerait-il donc, comme il le pensait, à une forme d’enchaînement de l’existence au passé ? Ce n’est pas l’avis de Serge Bimpage qui considère plutôt que « donner la vie ne se réduit pas à prolonger ce qui précède. Devenir père signifie reconnaître, reconstruire, réparer le passé. »
L’affirmation apparaît au début de « La Reconstitution » que publie un journaliste genevois (récemment devenu responsable du domaine culture/société à la « Tribune de Genève ») et on peut aussi y lire l’ambition de son livre : réparer le passé, au double sens du terme. C’est-à-dire raccommoder une filiation. Et rendre justice quand la vie fut injuste.
En reconstituant la figure énigmatique de son propre père mort il y a une dizaine d’années, Serge Bimpage fait le portrait d’un homme douloureusement prisonnier de ses illusions, à commencer par celle qui voudrait que le passé puisse être blanchi, révoqué, nié par la seule force de la volonté. Si l’auteur parvient à émouvoir, c’est qu’il demeure dans les limites d’une exquise politesse littéraire. « La Reconstitution » est un livre hautement conscient que le sentimentalisme serait non seulement une faute de goût infligée au lecteur, mais aussi une entrave à l’épreuve de vérité qu’il s’impose.
Serge Bimpage rassemble ainsi des souvenirs, fouille, enquête (il est vrai que c’est aussi son métier) et présente ce héros du banal qui fut son père. Un artisan en blouse blanche de la Genèvepopulaire. Un honnête Gepetto au milieu de son atelier rempli d’outils et de literies usagées (« Certains sont nés dans la soie, écrit Serge Bimpage. Moi dans la plume. ») Un homme d’apparence joviale mais hanté par l’horreur d’une « première vie » sur laquelle il demeure silencieux. Il a trente ans de plus que sa femme ; il pourrait être un grand-père pour son fils ; et il pense pouvoir se débarrasser de son passé en effaçant la moindre de ses traces. Sous la bonhomie de la vie quotidienne, le livre déchiffre cette illusion tragique.
A petites touches, avec tact, « La Reconstitution » brosse aussi un portrait d’époque. Serge Bimpage y retrace son apprentissage d’une Suisse qui réglait ses montres sur l’observatoire chronométrique de Neuchâtel et s’endormait une fois résolues les énigmes des pièces radiophoniques. On y voit paraître un temps où le général Guisan dominait encore toutes les salles de café sans qu’on songe pourtant à lui consacrer un péplum patriotique.
Michel Audétat
Construire
Bimpage, au nom du père, dans Construire
« Toute vie est héroïque, de la plus spectaculaire à la plus banale. » Surtout la plus banale, étant entendu que le véritable héroïsme n’a guère pour habitude de se pavaner en pleine lumière. Fort de cet argument, comme s’il en fallait un, le journaliste Serge Bimpage a osé composer un petit livre à la mémoire de son père.
Périlleuse acrobatie, tant ils abondent, ces portraits familiaux illisibles, d’un narcissisme et d’une naïveté souvent repoussante, comme les pustules sur l’épiderme d’un crapaud qui s’est trop rêvé prince charmant. Mais voilà : le livre de Bimpage est une réussite absolue, un miracle de justesse, de sincérité, de fidélité à ce qui fut. Et porté par une langue transparente, d’une modeste, d’une simple vérité.
La vérité d’un homme qui a refait sa vie à 50 ans passés suite à une série de revers et de douleurs jamais évoqués : le tapissier-décorateur Bimpage, figure du quartier des Augustins à Genève, épouse en deuxièmes noces une courtepointière entrée dans sa boutique à la recherche de quelque ouvrage. Et s’acharne au boulot, au service des rupins de Champel, hanté d’une seule obsession : la sécurité de sa nouvelle famille.
C’est un homme de parole, Bimpage, qui n’admet d’autre hypothèse que le futur, rageur face à l’étranger, mais qui fait preuve d’une bonté et d’un optimisme désarmant. Un homme habité par une seule méfiance : envers la force potentiellement destructrice des groupes. Même s’il fut franc-maçon et que son héros s’appelait Guillaume Tell. Un homme mal à l’aise en société mais toujours traquant la compagnie et beau parleur. Bimpage ne parle jamais de son premier mariage, ni de son père : il fut abandonné, enfant, par un pharmacien charlatan, vendeur de potions magiques, trafiquant de cocaïne, avorteur même. Aujourd’hui, le tapissier-décorateur Bimpage est un homme ressuscité, dans ses gestes, ses manières d’être, ses habitudes, par la plume de son fils tardif. Qui invoque Proust et l’évidence :
" Je me dis que donner la vie ne se réduit pas à prolonger ce qui précède. Devenir père signifie reconnaître, reconstruire, réparer le passé. Qu’un maillon manque, et la transcription – la mémoire – ne peut plus opérer. Et faute de mémoire, de racines, d’histoire, la vie, si elle devait continuer sa course, ne serait plus qu’errance. "
Laurent Nicolet
24 Heures
La Seconde mort d’Ahmed Atesh Karagün, dans 24 Heures
Cendres d'asile
C’est l’histoire d’un homme ordinaire. Un Kurde. Ni héros ni truand, Ahmed Atesh Karagun est simplement un solitaire, parfois un peu colérique.
Un 18 juillet 1982, fait divers dans un bistrot genevois. Quelques dégâts ; un demandeur d’asile est grièvement brûlé. L’enquête établit qu’en réalité, l’homme s’est mis le feu. Journaliste, Serge Bimpage reconnait ce Kurde. Il l’avait rencontré une fois par hasard – une soirée comme on le les oublie pas, un regard qui l’avait marqué au cœur. Pourquoi cet acte ? Une longue enquête est lancée.
« Ce récit est celui du silence. »
Le silence de Karagun, obstinément muet, ce silence, implacable, qui régnait dans la chambre de l’hôtel, Serge Bimpage le rencontrera tout au long de son parcours. « J’ai passé des soirées dans ces misérables chambres de bonnes, dans les greniers de nos maisons bourgeoises, dans les baraquements de saisonniers, à interroger les Turcs et les Kurdes qui avaient quelque peu connu Karagun. En vain. » Alors, le journaliste va essayer d’imaginer son itinéraire intérieur, de faire passer les quelques repères à disposition.
« La seconde mort d’Ahmed Atesh Karagun » n’est pas un roman. Une enquête sobre, ponctuée de documents aride. D’une lecture aisée, un style clair et saccadé de touches qui vont droit au but. Des mots simples, rocailleux comme les pièces du dossier, qui résonnent dans la tête. Bimpage emmène son lecteur avec lui, simplement, dans sa quête difficile. Avec sincérité : « D’horribles doutes m’ont assailli lors de mon enquête. »
Et voila qu’au bout du compte, sous le voile du silence, tant se devine, « Quoi ! cet homme incapable d’avancer le moindre commencement de preuve de souffrance dans son pays allait se plaindre de notre manque de sens humanitaire, à nous Suisses ? » Eh bien : ce désespoir qui le poussera à tenter le suicide, on arrive à le comprendre. L’itinéraire intérieur de Karagun a-t-il été celui-là précisément ? Au fond, c’est secondaire. Ce que Bimpage imagine a, quelque part, valeur de réalité.
On revit donc l’arrivée en Suisse d’un paysan fier, amer des souffrances de son pays, avide d’une nouvelle vie. On imagine son émerveillement devant la propreté, la prospérité. Plus dure sera la chute, entre tracasseries administratives et pression xénophobe. Alors, avec ses compatriotes, « ils cherchent à s’oublier eux-mêmes dans le vacarme des bistrots et le vertige des alcools ».
Une grève de la faim dans un église, et là, le point de non-retour est atteint, lorsque le compte rendu en parvient en Turquie. Karagun risque-t-il la mort s’il rentre au pays ? Les dépêches d’agences énumérées par l’auteur ne suffisent pas à le démontrer. Mais de là à nier le moindre danger…
Et puis, la goutte d’eau qui fait déborder la coupe. Karagun voit sa femme à l’aéroport, à travers une vitre. On empêche celle-ci de sortir, et on la refoule. « Karagun perd-il la tête ? C’est probable. »
Rideau. Karagun obtiendra un permis de séjour, avec sa femme et ses enfants. Pour invalidité.
Alain Maillard
Le Courrier
L’histoire d’Ahmed Karagun, le Kurde exemplaire, dans Le courrier
Le 18 juillet 1982, dans un café du quartier de Cornavin, un homme s’arrose soudain d’essence et flambe. Le scénario d’un polar de mauvais goût ? Pas du tout ! Le geste désespéré d’un Kurde auquel Berne vient de refuser, définitivement, le droit d’asile. Une histoire vraie, brutale, tragique qu’un « petit livre avisé et courageux », selon la formule de Georges Haldas vient rappeler « en temps opportun ».
L’histoire commence à Ahlât, une petite bourgade de deux mille habitants, en plein cœur du Kurdistan. C’est là que naît et grandit Ahmed Atesh Karagun.
En 1925, une terrible répression s’abat sur le village. C’est que, deux ans plus tôt, Mustapha Kemal Atatürk – le père des Turcs – a entrepris de transformer la Turquie en véritable « nation ». Vaste projet soutenu par une volonté impitoyable. Et qui ne tolère aucune opposition. Mustapha Kemal entend bien faire de son pays une puissance « occidentale » à part entière. Dans ce contexte, le Kurdistan fait tache : pays d’islam, il n’a pas sa place dans cette tentative d’imitation du modèle européen. On y envoie donc des soldats : massacres, pillages, viols et tortures. Suivent quelques accalmies, au rythme des Gouvernements civils et militaires qui se succédèrent à Ankara. Jusqu’à cette nuit du 12 septembre 1980, quand les tanks investissent lourdement la capitale : on lâche alors à nouveau l’armée à l’assaut de ce Kurdistan qui a l’outrecuidance de revendiquer son indépendance.
Démocrate sans être activiste dans la résistance, Ahmed Atesh Karagun est passé dans la tourmente et n’a plus qu’une idée : fuir… En pensant à cette photographie jaunie, aperçue – il y a bien longtemps – dans la maison du vieux chef de son village. Une photographie représentant un paysage suisse…
« Niet » fédéral
Serge Bimpage, qui fut journaliste au « Journal de Genève » avant d’entrer à « L’Hebdo », s’est placé dans les traces laissées par Ahmed Atesh Karagun. Remontant le temps, l’histoire et le silence, pour comprendre comment cet homme a pu tenter de s’immoler par le feu, un soir d’été, vingt et un mois après son arrivée en Suisse. Trois classeurs d’interviews, de coupures de presse, de rapports de police et témoignages pour retrouver le fil d’une histoire brutalement interrompue au bas d’un formulaire fédéral, net et sans appel. Inexorablement entraîné dans le dédale des procédures et des recours, Karagun est peu à peu miné par l’attente, l’angoisse et le désir impossible de commencer une nouvelle vie, entouré de Bervian, l’épouse laissée au pays et de ses deux enfants.
Aux limites de l’enquête, du document et du récit, le livre de notre confrère rend également hommage, indirectement, à l’action du pasteur Alain Wyler, qui accueillit dans les locaux de la paroisse des Eaux-Vives, pendant plus d’un mois, quarante Kurdes – parmi lesquels Karagun – qui n’avaient trouvé d’autres recours à leur expulsion imminente que la grève de la faim.
Ahmed Atesh Karagun n’est pas mort. Brûlé au deuxième et troisième degré, il a obtenu un permis humanitaire. Très cher payé, comme le montre « sans passion partisane » mais avec une franchise qui allie la rigueur à la sensibilité, le livre de sa « seconde mort ».
Jean-Bernard Mottet
La Tribune de Genève
La Seconde mort d’Ahmed Atesh Karagün, dans La Tribune de Genève
L’affaire Karagun ? Au départ, il y a un fait divers qui tournera au drame.
Le 18 juillet 1982, dans un bistrot de Cornavin à Genève, un homme s’inhibe d’essence puis boute le feu à ses vêtements. Et flambe comme une torche vivante. Qui est cet homme ? Un Kurde du nom d’Ahmed Atesh Karagun. Pourquoi cet acte ? Parce que Berne vient de lui refuser définitivement l’asile politique.
C’est une vie qui bascule d’un coup. Et une affaire que l’on oublie trop vite. Jusqu’au jour où le journaliste Serge Bimpage décide de reconstituer la trajectoire de Karagun, qu’il nous dévoile sous la forme d’un livre intense, qui dépasse l’enquête journalistique. En alliant documents et témoignages à un récit qu’il romance légèrement, il donne une chair et une âme à un personnage qui jusqu’alors n’existait que dans les dossiers administratifs. Et du même coup, confère au cas Karagun valeur et symbole, d’une actualité brûlante.
Au cœur du Kurdistan
Où commence-t-elle l’histoire d’A.A.K ? Dans une petite bourgade du nom d’Ahlât en plein cœur du Kurdistan, dans les montagnes de Turquie. Et cela a son importance pour le malheur de Karagun. Car, quand le général Evren prend le pouvoir après le putsch militaire de septembre 1980, une répression féroce s’abat sur ce Kurdistan qui cultive depuis longtemps des rêves d’autonomie. Les Turcs cassent à nouveau du Kurde, comme avant 1923. Il y a des peuples qui paient un peu plus cher que d’autres le droit à l’existence. Il ne faudra pas longtemps à Ahmed, jeune paysan kurde très attaché à sa terre, pour le comprendre.
Une vague d’arrestations et de tortures frappe les villages alentour et atteint quelques-uns de ses amis. Karagun n’a plus qu’une idée en tête : fuir ! Avant que le sort ne s’abatte sur lui et sa famille. Mais fuir où ? Il se souvient alors des paroles que son vieil agha lui avait tenues sur la Suisse, terre d’asile par vocation.
Un espoir fou
En débarquant à Genève, A.A.K. cultive un espoir fou. Il est libre, il va chercher du travail et fera venir sa femme dès qu’il le pourra. Mais il ignore qu’il arrive dans un pays de plus en plus sollicité par les réfugiés. Il ignore aussi que la Suisse entretient d’excellentes relations économiques avec la Turquie des militaires. Il ignore surtout que sa situation ne permet guère l’octroi de l’asile aux yeux des autorités.
Le premier interrogatoire de routine, peu après son arrivée, va en effet fixer son sort. : il dira franchement n’avoir jamais été menacé personnellement. Vrai ou faux réfugié ? Les choses ne sont pas si simples. Après les remarques pessimistes des policiers quant à ses chances à Berne, Karagun lâchera cet avertissement prémonitoire : « Si vous ne me gardez pas, je me tuerai ! ».
Triste parcours
La longue attente d’Ahmed Atesh Karagun à Genève va durer deux ans. Triste parcours fait d’angoisse, d’espoir et d’isolement, dont on pressent dès le départ qu’il finira en cul-de-sac.
Son attitude surprend de plus en plus les rares personnes qu’il côtoie, ce qui n’arrange rien. On le surnomme « Ahmed le Taciturne ». Et un fichu caractère avec ça : colérique et porté à la boisson quand rien ne va plus.
De sursis en sursis, de désespoir en grève de la faim, Karagun attend un miracle improbable. Les mois passent et tandis que l’étau se resserre autour de lui, le Kurde se terre, persuadé qu’il est lui-même le responsable de ce fiasco, certain qu’on le guette à chaque instant. Une tension qui frise la folie. Pui les événements se précipitent. Sa femme qu’il a fait venir à Genève est refoulée à l’aéroport et réexpédiée illico en Turquie. Là-dessus, Berne lui signifie un refus définitif. A.A.K s’effondre : il ne peut plus rentrer chez lui et ne peut plus rester en Suisse. Quatre jours plus tard, il décide d’en finir. Un conte oriental qui se termine mal.
Faire vivre une ombre
« Turcs alcoolisés : bagarre au spray ». C’est ainsi qu’une manchette et que la plupart des articles, le lendemain du drame, expédient l’affaire en quinze lignes truffées d’erreurs. C’est en partant d’une indignation que Serge Bimpage se lance sur la piste de Karagun : « Le Kurde n’existait pas. Dès le début, tout le monde a parlé à sa place. Mais dans la langue de bois des dossiers. J’ai voulu faire revivre cette ombre. » Serge Bimpage s’est pourtant bien gardé de tomber dans le piège qu’il dénonce. Et c’est là toute la force de son livre. Ni héros, ni martyr, Karagun est simplement victime d’un monstrueux malentendu qui repose sur l’ignorance. Et sur son propre silence.
Ce qui n’aurait pu être qu’une enquête au ras des faits prend, grâce à une qualité littéraire et à un rythme implacable, des allures de conte noir façon Cendrars
Paul-Henri Arni
Article paru dans « Bon pour la tête » Le romancier avait pressenti ce qui nous arrive!
«Déflagration», tel est le titre du roman du Genevois Serge Bimpage, ex-journaliste, devenu écrivain. A lire cette histoire bien tournée, écrite l’an passé, livrée à l’éditeur en janvier (L’Aire), on se pince. Ce diable d’auteur évoque une catastrophe qui s’abat sur la Suisse, différente de celle de ce printemps, mais curieusement semblable dans ses effets sur nos vies et dans nos têtes. Troublant, passionnant.
Tout commence cahin-caha. Un professeur d’université de Genève en est à sa cinquième rupture avec sa femme riche. Son aura académique et sa libido lui donnent quelques soucis. Ce qui ne l’empêche pas de multiplier les aventures avec d’éminentes et parfois dérangeantes collègues. Mais gare à l’étudiante provocatrice… Ses avances même repoussées peuvent très mal tourner. L’air du temps est cruel.
Le personnage, «un peu réac» comme il en convient, a ses certitudes, le «Petit Pays» qu’il étudie est un modèle insurpassable, «une île en Europe». N’allez pas lui dire qu’en dépit de sa prospérité il pourrait se découvrir des lendemains moins idylliques.
Un jour, lors d’un congrès en Espagne, son téléphone vibre. Alarme! Les ressortissants de cet eldorado doivent rentrer dare-dare au pays. Catastrophe naturelle du côté du Rhin. Nuage de cendres, inondations. Retour donc, si possible en montagne. Le prof retrouve le village de son enfance, quelques potes et quelques dames. Tout ce petit monde se retrouve bouclé entre chalets, église, maison de commune et cimetière. Cela se prolonge, les jours et les semaines passent, avec force de discours alarmistes à la télé. Conseillers fédéraux, experts de tout poil, taskforce et compagnie, journalistes, ils s’y mettent tous. En plus l’un des copains retrouvés rappelle sans cesse qu’à tout cela s’ajoute la menace climatique, pire encore. L’ennui, la peur et les bisbilles assombrissent le village. Tous sont saisis de ce que Bimpage appelle joliment la «nostalgiose». Ils se précipitent à la consultation du médecin local. Qui n’en peut plus et ferme le cabinet. Colère. Il est égyptien de surcroît! Ces étrangers, on ne peut pas compter sur eux… Et voilà que des réfugiés arrivent du nord, plus touché. Ils s’installent jusque chez les particuliers, avec leur dialecte impossible et leur goût des saucisses.
Bien qu’une énigme vaguement policière épice le récit, le livre n’a rien d’un roman noir habituel. On sourit très souvent au fil des pages. D’un sourire entendu, devinant ce qui se cache derrière les situations décrites avec légèreté.
Quant à l’Après qui finit par arriver, il ne ressemble bien sûr pas à l’Avant. Les intrigues se dénouent. Le village se vide. Les cours reprennent. Le prof recommande la lecture de son dernier ouvrage sur le Petit Pays, «l’Avenir d’une exception». Chamboulé, le prêcheur des certitudes rassurantes: «On aurait presque pu se réjouir d’avoir connu la catastrophe. N’était-ce pas elle qui nous avait vaccinés, préparés à nous défendre contre des agressions ultérieures et entraînés à relativiser la portée du bonheur comme du malheur?»
Que l’on se rassure, ce livre n’a rien du manuel de survie. Les péripéties amoureuses qui occupent le personnage, avant, pendant et après la catastrophe, l’occupent trop pour qu’il vienne nous faire la morale.
Une question nous taraude après cette lecture. A force de baigner au fil des ans dans les informations catastrophistes de toutes natures, n’aurions-nous pas ressenti, inconsciemment, comme l’envie un brin masochiste d’une accélération, d’un grand choc, d’une bascule soudaine? Bimpage, lui, parle simplement d’une «intuition». Chapeau. Mais on ne va pas faire de lui une voyante.
Jacques Pilet
Article paru sur le blog de Jean-Michel Olivier:
jmolivier.blog.tdg.ch
Angoisse et tremblements
Cinq ans après La peau des grenouilles vertes*, un polar inspiré par l'affaire de l'enlèvement de Joséphine Dard, Serge Bimpage, ancien journaliste au Journal de Genève, à l'Hebdo et à la Tribune de Genève, nous donne Déflagration**, son livre le plus abouti. Brassant une multitude de thèmes d'actualité (le réchauffement climatique, le mouvement #MeToo, le confinement, la collapsologie), il construit un roman riche et fort qui tient le lecteur en haleine d'un bout à l'autre de ses 500 pages.
Impossible de raconter les détails de cette déflagration sans risquer de jouer les spoilers! Il faut laisser au lecteur le plaisir de se faire mener en bateau, si j'ose dire, par une écriture alerte et surprenante qui vole de péripéties en rebondissements, multiplie les personnages et les intrigues, passe au scanner nos peurs et nos fragiles émotions.
Solidement construit en trois parties (avant, pendant, après), le roman suit les méandres et les doutes de Julius Corderey, professeur d'Histoire à l'Université de Genève et auteur d'un livre qui a fait date, autrefois, Une île au milieu de l'Europe (livre, par ailleurs, dont on ne saura rien). Mais la gloire est lointaine et fugace. Il ronge aujourd'hui son frein entre une épouse, la riche Inès, dont il passe son temps à se séparer, une assistante slave qui lui réservera quelques surprises, des étudiants médiocres et une mère, Amélie, qu'il a reléguée dans un EMS de luxe. Sa vie est une fragile construction qui menace à chaque instant de s'écrouler.
Et, bien sûr, c'est ce qui se passe!
Mais pas de la manière attendue. La première partie, menée tambour battant, repose sur un constat d'échec (sentimental et professionnel). C'est aussi un coup de semonce. Une sorte d'avertissement qui permet à notre professeur, « un peu réac et passéiste » de se réveiller et de trouver la force de se reconstruire, comme on dit aujourd'hui.
C'est alors que la catastrophe survient, parfaitement imprévisible (et à vrai dire quelque peu improbable). Le terre se réveille brusquement et se révolte. Le Petit-Pays, bâti sur une ancienne et profonde faille géologique est pris de soubresauts. Et des torrents de lave se déversent sur le plateau, formant une sorte de bouchon sur le lac de Constance et menaçant d'inonder les grandes villes du pays.images-4.jpeg L'hypothèse est séduisante (même si elle est fragile) et parfaitement d'actualité. Car cette menace conduit les autorités, pour protéger la population, à imposer un confinement qui ressemble beaucoup à ce que nous avons vécu (le roman de Bimpage, commencé il y a plusieurs années, a été rédigé avant la saga du Covid-19 et montre qu'une fois de plus les écrivains sont en avance sur leur temps !). Cette deuxième partie, qui ramènera Corderey dans le village de son enfance, Marmottence, au cœur du pays d'En-Haut, creuse à la fois l'angoisse de la catastrophe imminente et le besoin de retrouver des racines et un socle solide à sa vie (il est « confiné » dans le chalet d'Amélie et retrouve les gestes et les émotions d'autrefois). En plus d'une réflexion sur les changements climatiques, Bimpage aborde le thème des réfugiés, étrangers au petit village, qui viennent chercher refuge à Marmottence.
Quelle conclusion apporter à ce roman touffu et très hégélien (thèse, antithèse, synthèse) ? Après tant de bouleversements, comment ce brave professeur Corderey va-t-il réagir ?
Il a beaucoup changé, comme tous les habitants du Petit-Pays. Il a tenté de faire de l'ordre dans sa vie en se débarrassant du superflu ou du superficiel. L'après va-t-il ressembler à l'avant ? Ce serait dramatique. On sent Bimpage partagé entre son désir de changement (tout recommencer à zéro) et son aspiration à revenir à la vie d'avant (une vie somme toute routinière et bourgeoise). Il y a bien quelques lignes de fuite, en particulier du côté des collapsologues qui se réunissent en secret à Marmottence pour préparer la fin du monde. Mais on sent que l'auteur n'y croit pas. Pas plus qu'il ne croit au retour au status quo ante. Cette conclusion laisse le lecteur dans l'expectative et le renvoie à ses propres interrogations.
C'est un livre important que ce Déflagration de Serge Bimpage — un livre qui ne laisse pas le lecteur indemne et fait trembler en lui des peurs très anciennes et irraisonnées. L'auteur y a mis beaucoup d lui-même et il ne triche pas. Ses personnages nous accompagnent encore bien après que l'on a refermé le roman.
Une réussite.
Jean-Michel Olivier
Article de Gilberte Favre, sur le blog « Itinéraires »
Avec Déflagration**, le très intuitif auteur genevois nous propose une préfiguration du confinement que nous continuons de vivre de part en part de la planète.
Son personnage principal, le professeur Corderey baigne dans le confort douillet de son appartement genevois lorsqu'il doit brusquement se replier dans son village d’origine. Tout cela, par la faute d’un volcan devenu turbulent, au Petit-Pays. Le professeur doit brusquement changer de vie, comme certains après le Covid 19 ou la double explosion de Beyrouth. Mais, chose surprenante, le grand voyageur Serge Bimpage a écrit ce livre avant ces événements.
«Le couchant commençait à rosir les toits du village qui se rapprochait maintenant... Toutes choses que le touriste ne pouvait percevoir. Pour cela, il lui aurait fallu lire dans l’âme des citoyens. Et qu’y aurait-il vu ? Une crainte sourde et fiévreuse, celle d’une apocalypse qui pourrait se déclencher à tout moment si Dieu, soudain, devait cesser d’aimer le Petit-Pays et le détruire avant de tout recommencer depuis le début.»
Savoir que Serge Bimpage a accompli un tour du monde de deux ans en auto-stop. Et que cette expérience – « Les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent pour partir», écrivait Baudelaire –, inaugurera de très nombreux voyages. Et des livres dont le plus surprenant est Déflagration car en phase avec une actualité inattendue.
Gilberte Favre
Jean-François Duval, écrivain
« Déflagration » de Serge Bimpage (éd. de L’Aire). 535 pages. Cela ne peut être lu en 5 minutes. Ceci dans la tradition réaliste que pratiquait en Suisse romande un Jacques Chessex (par exemple), mais ici avec des pointes d’humour en plus, il est question d’ordinaire et d’extraordinaire. Par exemple, dans laquelle de ces deux catégories rangeriez-vous la Suisse ? Est-ce un pays ordinaire ? Ou extraordinaire ? C’est tout l’enjeu du roman de Bimpage : son protagoniste appelé Julius Corderey et prof d’histoire à l’Université de Genève, va, au fil des chapitres, se métamorphoser intérieurement, se transformer complètement sous la pression, il est vrai, de certains éléments extérieurs tout à fait extraordinaires. Parce que l’extraordinaire aide parfois à mieux mettre en évidence ce qui constitue notre ordinaire. En ce sens, ce roman de Bimpage est aussi une fable, proprement renversante, volcanique. Voit-on la Suisse comme un carcan ? Comme un pays étroit et borné ? Fermé ? Figé, confit dans son passé et ses certitudes ? Alors, qu’on le fasse sauter, éclater, ce carcan ! A cette fin, Bimpage n’hésite pas à créer une situation inédite que ne renierait pas Jules Verne : l’écorce terrestre se soulève du côté du lac de Constance, un volcan jaillit, prend des allures de Stromboli, et la Suisse tout entière se voit soudain menacée de disparition. Le Petit Pays, ainsi qu’il est appelé dans ce livre, pourrait bien couler, être englouti. A moins que… ? Quand on se trouve devant phénomène d’une pareille force volcanique, que faire ? comment réagir ? Si ce « Petit Pays » est doté d’une pareille énergie, aussi volcanique, qu’en faire ? Comment en user ? Certaines déflagrations sont salutaires. Celle-ci le sera-t-elle ? Il faudra suivre le professeur Corderey dans maintes péripéties, pour enfin, avec lui, considérer peut-être le Petit Pays d’un œil nouveau. Salvateur.
Jean-François Duval, écrivain
Article paru dans "Le courrier"
Serge Bimpage ne s’en cache pas dans sa préface: il serait fort possible qu’il ait été l’objet de l’intuition d’une catas-trophe imminente en Helvétie quand l’en-vie lui a pris, il y a trois ans, d’imaginer un cataclysme dans son septième roman, ac-cepté par son éditeur tout juste une se-maine après que le premier cas de corona-virus se soit déclaré. Mais qu’importe la fin du monde, l’heure est plutôt à l’humour, grinçant comme le manie si bien l’ancien journaliste, usant d’une verve élégante où l’ironie fait mouche à chaque page.
Déflagration est de ces romans-fleuves qui, malgré quelques longueurs, se targuent de donner naissance à un homme, à sa vie, à son œuvre. Et quel homme! Julius Corderey, professeur d’université, distingué par l’Ordre des Palmes académiques, en-seigne l’histoire de son «Petit-Pays» adoré, vénéré, adulé. On se surprend à rire, presque avec tendresse, de celui qui, bardé de ses certitudes, absorbe sans trop broncher les coups que le sort s’acharne à lui faire tomber sur la tête. Des coups essentiellement portés par des mains féminines, avouons-le. Sa femme le quitte pour la cinquième fois, son assistante joue de toutes les duplicités et se montrerait presque plus intelligente que lui, une étudiante lui prête d’innommables outrages, sa maîtresse le méprise, sa mère se meurt, et la première page de son futur essai, un succès évidemment, reste désespérément blanche. Il faudra qu’un volcan se réveille en Suisse pour que le pauvre hère se sente dans l’obligation de se délester de quelques-unes de ses convictions patriotiques... Pour son plus grand bien, n’en doutons pas.
Amandine Glévarec
Article paru dans la "Tribune de Genève" et dans "24 heures"
Et si la Suisse était menacée d’un péril conduisant à confiner ses habitants? Un air de déjà-vu? L’idée de son septième roman est pourtant venue au Genevois Serge Bimpage il y a trois ans lors d’un séjour au sud de l’Italie avec vue sur le Stromboli, et le livre a été accepté par l’éditeur le 6janvier. Une Suisse renommée «Petit pays» s’y trouve aux prises avec une éruption volcanique, que l’auteur a imaginée plus à titre de métaphore que dans une visée d’anticipation. À l’aune de cette nouvelle donne, il examine la vie de l’historien Julius Corderey, professeur réputé, «décoré de l’Ordre des Palmes académiques». Bien installé dans ses certitudes comme dans sa demeure chic de Genève, puis replié dans l’appartement de sa mère décédée après la cinquième rupture avec son épouse, il n’aurait jamais imaginé devoir se réfugier à Marmotence, le village de montagne de son enfance, pour un interminable hiver où il devra même partager son chalet avec une réfugiée venue de Suisse alémanique. Teinté d’ironie, ce foisonnant roman questionne par la multiplicité des personnages, des points de vue et des thèmes la position de la Suisse, les certitudes trop bien ancrées, mais aussi le potentiel de changement d’une telle crise.
Caroline Rieder
Article paru dans "Le Regard Libre"
C'est une expérience impressionnante que la lecture de Déflagration. Roman écrit par l’ancien journaliste romand Serge Bimpage, il raconte l’éruption d’un volcan au Nord de la Suisse, qui va provoquer une inondation… et un confinement généralisé. Le livre a été accepté par l’éditeur Michel Moret le 6 janvier 2020. Il a été écrit durant les trois ans qui ont précédé la pandémie. Comme tient à le noter l’auteur dans un avertissement, aucun mot n’a été changé ou ajouté au texte original. Une coïncidence bluffante avec notre présent, et surtout un récit poignant, intelligent et émouvant.
L’histoire est pour le moins originale. Il fallait avoir l’idée, comme on dit. L’idée, Serge Bimpage l’a eue en sirotant un verre de vin blanc, sur sa terrasse en Sicile. Face à son regard, la fumée d’un volcan. «Etait-ce le soleil qui tapait fort, ou la Malvoisie, devant le spectacle du volcan dont le nuage semblait grandir et noircir: j’ai eu peur pour mon pays! Une crainte d’autant plus irrationnelle, bien sûr, qu’il n’y existait pas de volcan, suffisamment forte cependant pour en imposer la métaphore. Si l’on n’y prenait garde, d’invisibles périls menaçaient la minuscule nation au centre de l’Europe.»
Le roman, c’est cette métaphore. Celle qui, avec l’image de l’irruption d’un volcan, donne à voir ce que serait l’irruption de l’inédit, de l’imprévu, de l’impensable et de l’indésirable dans un pays, la Suisse, qui se sent très souvent, trop souvent, à l’abri de tous les dangers et de tous les excès. C’est pourtant déjà un excès de ne pas se sentir concerné par l’adversité, et déjà un danger. Déflagration est également un roman sur le tragique. La mort, l’injustice de la nature, l’interconnexion. Bref, ce qui nous dépasse. Et cette réalité est amenée de manière très concrète et souvent drôle par l’entremise du personnage principal.
«Les chevaliers sont seuls. Ils s’enfoncent dans la nuit, comme Corderey maintenant. On ignore où ils vont, où ils dorment avec ce froid mais on sait qu’ils ne sont pas du genre à se jeter au lac, oh ça non! Ayant fait une brève halte devant quelque échoppe, ici la marchande de marrons, avec son gros chandail de laine qui pue, ils repartent la tête haute, emportant avec eux son sourire et la vision de ses seins généreux qui suffit à leur sommeil provisoire.»
Ce héros, comme il voudrait sans doute lui-même qu’on le qualifie, c’est Julius Corderey, un professeur d’université un peu réac’, un peu pommé, mais qui partage avec ses collègues – qu’il méprise – la quintessence du prof d’uni: un égo surdimensionné. Corderey est un type qui boit à sa propre santé. Sa vie se résume à des réflexions sur le thème auquel consacrer son prochain essai pour vendre un max («Il ne restait qu’à dérouler la pelote. Rappeler nos valeurs. Dénoncer Schengen et en route pour le best-seller»), sur les méthodes à mettre en œuvre pour charmer ses jeunes assistantes ou homologues, sur ce que vont penser ses confrères de ses sorties à propos de l’exception helvétique. Bref, un mec qui aime user de son pouvoir. Mais qui s’est fait larguer par sa femme. Et qui reçoit la plainte d’une étudiante. Le contexte du bouquin, c’est la Suisse orgueilleuse, mais c’est aussi #MeToo.
«Il regarda sa montre. Il n’était que quinze heures. Encore deux à tirer pendant lesquelles le public boirait les paroles de ces clowns.Tenter une main sur son genou. Au dernier rang, il faisait sombre, personne ne s’apercevrait de rien. Mais comment réagirait-elle? Peut-être positivement, Ghislaine lui avait avoué son fantasme de se trouver en pareille situation (ndlr: il s’agit ici de Consuela, une autre).»
Et ce qu’il y a de très bien amené dans cette histoire, c’est que pareillement à l’inondation qui va secouer le «Petit-Pays», l’accusation de harcèlement que va subir Corderey – subir, oui, car la plaignante s’avère être une menteuse – délimitera une «vie d’avant» et une «vie d’après». D’ailleurs, le long roman est divisé en trois parties, «AVANT», «PENDANT», «APRÈS». Une correspondance de plus, évidemment, avec la pandémie que nous traversons et le vocabulaire que nous avons adopté, l’air de rien, dans la vie de tous les jours. Covid, monde d’avant, monde d’après, confinement, quarantaine… Même la phrase de Macron est prophétisée, avec un personnage affirmant que lui et ses congénères sont «comme en période de guerre».
«Sa vie d’avant. Le doyen la lui présentait sur un plateau. Avec les excuses du décanat, assorties de la promesse des pleins pouvoirs pour remodeler le département, alors qu’est-ce que vous en dites? Corderey était resté silencieux. Reprenait-on sa vie comme avant un tsunami? Non, bien sûr, le doyen devait s’en douter. Il en faudrait du temps, pour rétablir sa réputation ternie. Et lui-même n’était pas certain de se retrouver tel qu’en lui-même.»
Quand on dit que la littérature raconte le monde plus que n’importe quel autre médium, eh bien là nous y sommes. Lire Déflagration convaincra toute personne qui ne serait pas encore convaincue de la puissance des romans. «La pensée ne fait pas de miracle. […] L’art va plus vite ou plus profond. Il ne donne à penser qu’en donnant à ressentir, à aimer, à admirer», écrit André Comte-Sponville dans L’inconsolable et autres impromptus, dans le chapitre sur Beethoven. En d’autres termes, l’art anticipe sur la pensée. Serge Bimpage, c’est officiel, a eu l’intuition du grand événement des années deux mille vingt, voire du XXIe siècle.
A lire aussi: L’éternel retour des romans
Pourtant, quels médias romands en ont parlé? Si peu! Sans-doute préfère-t-on inviter les gens à faire du yoga avec Emmanuel Carrère, plutôt qu’à réfléchir avec Serge Bimpage sur l’exception suisse, dont les deux sens «singularité» et «prouesse» sont encore et toujours à expliquer, critiquer, remettre en perspective… et quoi de mieux que le roman pour cela! Le lecteur y rencontre des choses – un fusil, un chalet, des frontières… un syndic – qui condensent les grands débats nationaux, il assiste à l’évolution psychologique d’un personnage, passant du cynisme à la mélancolie, de l’inconscience amorale à la conscience du tragique. Avec l’idée de «ne pas être le seul à être seul.» Et il lit enfin ce qui est peut-être le plus incroyable des pressentiments de Bimpage:
«Le Petit-Pays n’était plus le chouchou de Dieu. Il se présentait comme l’inverse de ce que les citoyens en avaient attendu. Et qu’en avions-nous attendu? De l’anticipation! Condamné à tout prévoir, notre Petit-Pays excellait dans l’anticipation, au point que nous en étions arrivés à regarder les choses de haut, de si haut que nous ne savions d’ailleurs plus être terre à terre. Et voilà que plus l’eau montait, moins le pays anticipait. Le mal les contaminait tous. Même les jeunes, angoissés de rien, se mettaient à interroger les anciens, et leurs questions ne rencontrant que l’écho désespéré de l’impuissance, le vague à l’âme finissait par les submerger aussi.»
Jonas Follonier
Ce livre marque l’aboutissement de la maturité littéraire de Serge Bimpage. Désormais, il le classe parmi les meilleurs auteurs romands de sa génération. Ce dernier peut être fier de cette réussite et goûter avec sérénité aux hommages qui lui sont dus. Le style est maîtrisé, le souffle est là pour écrire au long cours, bref, Serge Bimpage est un véritable « écrivain », titre qu’on ne peut s’octroyer à soi-même par modestie, et qui ne peut venir que de la reconnaissance des autres.
Christian Vellas, écrivain
Article paru dans "24 heures"
Les fictions de l’écrivain genevois sont d’inspiration autobiographique mais sans narcissisme. Dans son dixième livre Le Voyage inachevé, * Serge Bimpage nous fait partager avec une élégance stylistique raffermie, et une verve conjuguée à la troisième personne, les peines et joies du tour du monde de ses vingt ans. Une odyssée qui dura 18 mois, lui fit parcourir (en train, charters, bateaux, cars et auto-stop) les trois Amériques, explorer les îles Galápagos, celle de Pâques. Puis Tahiti, Singapour, la côte malaise, l’Inde, la Thaïlande… Retour dans sa ville natale à 23 ans. «Un jour, il faut bien rentrer, rumine son nouvel avatar Anteo. Amorcer le virage de la Corraterie. Tenir serré le sac à dos dans le tram 12. Pour ne pas déranger. Affronter le mutisme des passagers. Leur âge. Leur réprobation muette. Le tram avançait avec une lenteur de corbillard.» De cette époque un chouia baba-cool et dont il rigole, Serge Bimpage conserve pour les retransmettre fidèlement des couleurs impressionnistes, pas défraîchies. S’il voyage moins longtemps, car la planète s’est étrécie, l’auteur se reste fidèle: une sveltesse de trentenaire, car à 59 ans, il ne se déplace à Genève qu’à bicyclette. Yeux lagon sous de broussailleux sourcils ogivaux, sourire éclatant que la barbe devenue poivre et sel rend fraternellement moustakien. Et une voix, plus ambrée que d’ombre, capable de s’altérer pour imiter celles des autres. Elle s’affûte onctueusement, quand il évoque une des plus enrichissantes rencontres de sa vie, en 1985, dans l’Etat du Maine: le «sphinx» Marguerite Yourcenar, cinq ans après l’élection de la grande dame à l’Académie française. Elle lui avait accordé une interview au pied levé en sa thébaïde de la péninsule de Mount Desert, pourtant archimblindée contre tout assaut médiatique. Le journaliste Suisse de 34 ans et son épouse Tiziana furent accueillis dans une caverne philosophique où le portrait de l’empereur romain Hadrien irradiait sur une paroi. Bimpage lui avait-il avoué qu’il était aussi écrivain? Toujours est-il qu’elle lui souffla un conseil qu’il retiendra comme un viatique: «Jeune homme, le monde est une prison. Comment être assez fou pour mourir avant d’en avoir fait le tour?». Cette interview de Yourcenar parue dans un journal suisse sera d’ailleurs consignée dans l’édition de la Pléiade de ses œuvres. Or Serge Bimpage évoque ce scoop littéraire sans fierté manifeste, avec un air de tristesse et une culpabilité inavouée qui doit sourdre d’une sève calviniste qu’il n’aime guère. Depuis sept ans qu’il a abandonné le journalisme pour «se précipiter dans l’indépendance», il gagne son pain en jouant les communicants au service de diverses institutions. Il lui est même arrivé d’être le porte-parole de l’Eglise de Genève. Souvenir peu radieux. Le voici plus proche de l’italianité de son épouse, et d’émotions culturelles, culinaires et épicuriennes que sa Rome protestante natale réprouvait.
Cela dit, il aime sa ville éperdument. Enfance dans le quartier pauvre de la Roseraie, près de l’Hôpital cantonal, au pied de la colline de Champel réservée aux nantis. A l’école primaire, qui se trouve à équidistance, on instruit sans distinction des élèves des deux catégories. «Mon père était tapissier-décorateur, comme Molière! Un caractère calviniste. Inoubliables les moments où je l’aidais à hisser une livraison de matelas sur le chemin bien nommé de l’Escalade, et qui devaient être livrés aux riches d’en haut.» Pour sa mère, qui vit encore mais en souffrance, il éprouve des sentiments compassionnels qui ressortissent à l’histoire de la Dernière Guerre mondiale. Une Suissesse qui vécut en France, à proximité de la prison lyonnaise où le nazi Klaus Barbie avait perpétré les atrocités qu’on sait. Elle y vit périr de maladie des frères et des proches. «Elle n’a rien oublié, son esprit est hanté par la guerre. Mais elle a aussi un côté rabelaisien. Elle aime fabuler, inventer des histoires.»
Maman d’écrivain.
Gilbert Salem
Article paru dans le Journal des Trois-Chênes
Le nouveau roman de Serge Bimpage offre un regard sur la Suisse actuelle, l’héritage de son histoire et les enjeux présents et à venir. Une détonation pour réveiller les consciences, des plus larges aux plus fermées
Déflagration, c’est une histoire du Petit-Pays, dans le Petit-Pays. On y suit Julius Corderey, antipathique professeur à l’Université de Genève, désagréablement crédible, un féru d’histoire suisse aux idées bien tranchées qui se verra forcé de se remettre en question. Si, au départ, les malheureux tournants de sa vie personnelle ne semblent pas le toucher à la hauteur de leur gravité, c’est par la suite un volcan qui triomphera de l’esprit fermé du spécialiste.
Une catastrophe naturelle en terres helvétiques
Un volcan en Suisse. Aussi impressionnant que cela puisse être, ce n’est pas le danger le plus menaçant, la flamboyante montagne se contentant de cracher cendres et gaz un peu plus loin, au nord du pays. «Rasez les Alpes, qu’on voie la mer!», l’ironie frappe Corderey, lui qui jadis scandait son mépris à un pays trop petit pour marquer l’Histoire, à présent certain de la perfection inégalable de celui-ci: son petit monde pétri de certitudes s’effondre lorsqu’une menace de mer intérieure fait suite à la première déflagration. Le Petit-Pays n’est plus reconnaissable, ni ses paysages, ni ses habitants en panique. Plus que le théâtre des événements du récit, la Suisse est presque personnage, elle est en tout cas objet de nombreuses discussions et réflexions, source d’amour ou de désintérêt, tour à tour Eldorado, contrée discrète plus à la merci de l’Histoire que membre actif de son écriture, ou encore tortue repliée sur elle-même, vainement craintive de ses bordures extérieures.
Des paysages signifiants
Le Petit-Pays s’habille de deux paysages distincts. D’abord, la grande ville universitaire qu’est Genève, lieu de résidence du protagoniste et point de départ du récit, posant la situation de base du personnage, une vie «parfaite» esquintée par le temps et surtout Corderey lui-même. Rien ne roule plus, tout grince dans le vie genevoise du personnage: amours, travail, réputation et aspirations. Puis, le village de jeunesse retiré qu’est Marmotence, délaissé et figé, s’imposera par la force des événements. Ajoutée à cela, une ville extérieure semble apporter une bouffée d’air frais au personnage avant le drame, Cordoue. Théâtre de conférences universitaires réunissant tous horizons, préservée du tumulte suisse, l’auteur chênois y voit en partie sa commune, une image de Chêne-Bourg, multi-éthnique et culturellement riche. Le récit plonge donc le lecteur dans ces trois espaces, ainsi que dans trois temporalités rythmant le tout: avant, pendant et après. Une idée du temps marqué par la catastrophe qui s’étend à la genèse du roman, remarquable par son indépendance thématique malgré la crise actuelle.
Un récit lucide
En effet, écrit l'an passé, arrivé entre les mains de l'éditeur en janvier, Déflagration impressionne d'abord par sa clairvoyance. Provoqués par un mal certes différent de celui qui nous a surpris il y a quelques mois de cela, les mesures déployées et les états d’âmes des citoyens dans le roman face au chaos font étrangement et précisément écho à notre crise sanitaire, alors que le texte reste inchangé malgré l’apparition des premiers cas. Mais plus que cet instinct avisé, c’est un optimisme profondément ancré qui imbibe ces pages. Et cela sans que l’on s’en aperçoive tout de suite, le début du roman ne laissant pas nécessairement filtrer la notion d’espoir. Un avant en chute libre, un pendant «impensable»; la peur est présente, mais nécessaire, permettant de se préparer au pire, voire d’éviter la source de nos craintes. La peur, la «nostalgiose», le bouleversement, tout cela transforme la vie du protagoniste et ouvre une fenêtre donnant sur un après plus heureux.
L'évolution d'un personnage opiniâtre
Considéré comme son roman le plus abouti par l’auteur lui-même, Déflagration dessine l’itinéraire moral d’un personnage trop bien campé sur ses idées mais qui, malgré son statut privilégié, sa place dans la hiérarchie universitaire et l’expérience des années, suivra un apprentissage forcé et cependant bienvenu. Un changement nécessaire pour éviter le mur qui se dresse droit devant, une leçon de vie à la portée de tout un chacun, peu importe l’âge et la condition. Corderey découvre un Petit-Pays différent de celui qu’il s’efforçait de figer dans ses recherches, où les enjeux s’entremêlent, où l’écologie, l’économie, les droits de l’homme et ceux de la femme, doivent être envisagés en regard. Il prend conscience de l’attitude consumériste actuelle de l’humain, reflétée par son propre comportement prédateur. Il apprend que la menace réelle était terrée au fond de lui, tout comme le danger planant véritablement au-dessus de la Suisse provenait des entrailles de son propre sol. Finalement, une phrase empruntée à Adam Biro marque le récit et résume l’état des choses: «Espérons que nous serons à la hauteur du malheur qui nous échoit». Reprise par le narrateur à la dernière page, le «malheur» laisse place au «bonheur», l’espoir est vivace.
Kelly Scherrer
Jean-Michel Olivier
Voici un très beau livre, à la fois poétique et initiatique, une quête de soi et une recherche du « point de fuite » qui oriente toute vie, écrit, ce qui ne gâte rien, dans une langue magnifique.
Je connais Serge depuis 40 ans, et plutôt bien. Il a été un excellent journaliste et il nous le rappelle grâce à son art du portrait et sa curiosité des hommes. Il m’épate une fois encore. Chacun cherche son île : Serge l’a trouvée à Lipari, sur ces îles éoliennes qu’Ulysse a eu tant de peine à quitter…
Jean-Michel Olivier
Corine Renevey, La Compagnie des Mots
Il est vrai que ce livre est un petit bijou, une roche obsidienne dérivant au large de la botte, comme une place à mériter.
Quel périple : à la fois découverte de Lipari (son histoire, sa culture, ses habitants) et quête du personnage énonçant son énigme — identitaire — qui se profile et se révèle au fil de la *restructuration* d'une ruine en Palmento. Projet porté malgré la loi usucapione (qui existe aussi en France), les réserves de l'aimée « serions-nous fous ? bâtir si loin », sans oublier l'absence d'autorisation de construire ! Mais les coups de foudre, comme les éruptions du Stromboli, ne s'expliquent pas.
J'ai aimé les images gourmandes de l'île : sa pierre ponce, sa poussière, sa blancheur se transformer en panettone glacé ! Le lieu que les écrivains cherchent : « ces mineurs de fond ». Et le jumeau, le double à qui le personnage s'adresse avec un « tu » ambigu : car l'autre est aussi double. Elle le dit qu'il voit un pressoir là où est une ruine : pourra-t-il extraire des pierres une substantifique moelle ? Elle le dit encore qu'il l'aime — l'île, mais elle aussi — à la fois dans sa réalité et dans son esprit. La réalité de l'île est âpreté : passé antique fait d'exploitation ouvrière, d'emprisonnement, d'exil, de migration, de ferrailles et de disparition (les tortues), mais les îles éoliennes sont aussi patrimoine : tradition orale, écoute des histoires, odyssée, cinéma... Bref, pour prolonger cette belle expérience de lecture, nous regarderons le Postino, puis Stromboli.
Corine Renevey
Alain Renoult, écrivain
De retour de notre île, je me suis lancé dans la tienne.
Quel plaisir j’ai eu de m’y retrouver !
Ton livre est une ode à l’amour. Un roman d’amoureux de l’île et bien sûr de celle que que tu désignes à la deuxième personne...
C’est l’un des plus beaux livres que tu aies écrit. Il se lit comme un récit de voyage. D’ailleurs, certains passages m’ont fait penser aux écrits de Nicolas Bouvier. Cet ami très cher qui nous manque terriblement.
On se promène dans ton livre comme tu nous a promenés à Lipari.
Que te dire de plus. Chaque page est un enchantement non seulement par le fait que nous y sommes allés, mais également par le fait que tu ES. Au sens où l’on sent que chaque mot, chaque phrase est TOI.
Un TOI voyageur autant que poète.
Bref j’ai adoré te lire. Tu as l’art de nous interroger. Et même si l’Iddu gronde, j’aime ce grondement divin. Il me rappelle nos dieux grecs que nous côtoyons de près lorsque nous sommes à Samothrace.
Alain Renoult
Entretien avec Sita Potacheruva, Radioliteractif sur Radio Cité
Présentation à la Compagnie des Mots
Entretien avec le comédien Vincent Aubert pour la Compagnie des Mots.
la Compagnie des Mots.
Critique: Le Voyage inachevé
Roman du passé mouvant, «Le voyage inachevé» est aussi une odyssée spirituelle
Tenter l'esquisse de celui que l'on est. Pour cela, prendre le Le VC age temps pour abscisse et l'espace pour ordonnée. Et ne pas s'étonner de découvrir, au final de la démonstration, que le point d'intersection se déplace sans cesse et avec lui toute possibilité de résolution.
Pour Anteo, le personnage principal du Voyage inachevé, peut-être ce point se situe-t-il vingt ans auparavant, dans l'aéroport de La Paz, tandis que Nomia lui adresse un ultime sourire avant de le quitter. Leur amour s'était délité au fil des paysages, comme si la distance.parcourue s'était sournoisement glissée entre eux. Comme si, également, trop de prc»amte ne pouvai cette distance. Les voyages ont des vertus révélatrices dont lajeunesse ne se méfie pas.
Un passé qui n'en finit pas
Deux décennies plus tard, Nomia ressurgit de ce passé décomposé, via un courriel qu'elle adresse à Anteo. En guise d'hameçon, elle lui parle de ses notes de voyage qu'elle aurait soigneusement conservées. La ficelle est de taille, mais c'est se satisfaire du présent que de renoncer à la saisir. Et le présent, pour Anteo, c'est désormais la galerie d'art genevoise d'où il regarde les gens passer et l'amour tranquille pour Solange, son épouse.
Alors, il tire la ficelle et avec elle ce jeune homme qu'il fut et sur le passage duquel il s'est si peu retourné. Au point d'être dans l'incapacité de répondre à la question, que lui pose un jour une journaliste: «Qu'avez-vous fait de vos 20 ans?» Voilà pourtant que tout lui revient, avec une terrible acuité: Lester et sa djellaba blanche, les lectures de Castaneda, les événements au Chili, l'«irréelle et rebelle Calipso», le sentiment «qu'en voyage tout est possible».
La permanence du désir
Le voyage inachevé n'est pas seule-
ment le récit d'un amour perdu auquel la nostalgie accorderait une saveur artificielle. Il transcende la romance pour questionner l'idée de perte, celle de l'inaccompli et du désir de vivre. En dépit des nécessaires renoncements, ce dernier reste intact chez Anteo. «ll continue de désirer, de s'étonner, de regarder toutes choses comme un gosse, de se demander ce qu'il y a sous lesjupes de l'existence, derrière les murs, les non-dits, les faux-semblants», écrit Serge Bimpage à propos de son personnage.
L'auteur ne déploie la carte de ses périples que pour y inscrire son propre cheminement intérieur. Le roman se déroule ainsi sur plusieurs plans qui, gâce à une structure narrative ingénieuse, tantôt se superposent, tantôt s'opposent. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si Anteo et mie». C'est par ses contradictions que l'homme se définit, puisant dans ses tiraillements de quoi se remettre en question et rester ainsi «vivant». «Calviniste par son père» et «rabelaisien par sa mère», Anteo en sait quelque chose. Et notamment qu'il n'y a que des voyages inachevés. Celui-ci est superbe. Lionel Chiuch
«Le voyage inachevé» de Serge Bimpage. L'Aire. 204 pages.
Serge Bimpage signe son cinquième roman. DR